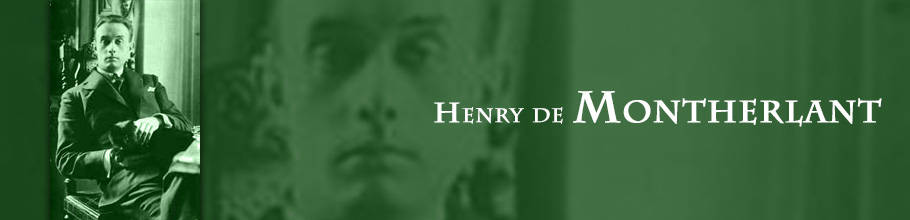
Biographie
5. Le repli sur Paris - Première partie : de 1945 à 1951, Montherlant dramaturge
Montherlant va publier et faire jouer plusieurs œuvres théâtrales vu le grand succès de La Reine morte durant la guerre.
- Malatesta, écrit en 1943-1944, sera édité en tirage limité en 1946, et créé en 1950 au Théâtre Marigny par la Compagnie Renaud - Barrault.
- Le Maître de Santiago, écrit en 1945, sera publié en 1947, et créé en 1948 au Théâtre Hébertot à Paris.
- En 1949, création de Demain il fera jour au Théâtre Hébertot. Cette pièce est une suite à Fils de Personne créé en 1942.
- En 1950, création de Celles qu’on prend dans ses bras au Théâtre de la Madeleine.
- En 1951, La Ville dont le Prince est un enfant sort en volume.
1943-1944, Malatesta (publié en 1946)
 |
|
|
Sigismond |
Il s’agit ici de Sigismond de Malatesta (1417-1468), seigneur de Rimini, issu d’une famille de guerriers (condottieri) italiens. Il combattit pour le Pape, puis pour Venise et contre le Pape Pie II. Vaincu, il fut excommunié. A Rimini, il protégea les artistes et les savants. Lire à son sujet : Marie-Madeleine Martin, La vie de Sigismond Malatesta, Ed. du Conquistador, Paris, 1951.
Pièce en quatre actes, écrite en 1943-1944, et créée au Théâtre Marigny le 19 décembre 1950, par la Compagnie Renaud-Barrault. Projetée à la Télévision française en avril 1967.
Dans Va jouer avec cette poussière, NRF, p.165, Montherlant raconte que le célèbre acteur Louis Jouvet voulait jouer le rôle de Malatesta, mais “une très puissante influence l’en dissuada, lui faisant comprendre impérativement que son talent devait être mis au service de certains auteurs et non d’autres”.
Montherlant commença à écrire cette pièce à Grasse en 1943 (chez Marguerite Lauze ?).
Dans un avant-propos daté de 1947 (Théâtre, Pléiade, p.337), il insiste sur le caractère de l’homme de la Renaissance imprégné tant dans la vie privée que dans la vie publique par les souvenirs de l’antiquité. Les grands hommes de la Rome ancienne sont donc des exemples agissants pour le Renaissant italien, et donc pour Malatesta.
 |
|
|
Pape Pie II. |
En écrivant Malatesta, dit Montherlant, je n’ai rien inventé.
“Sa nervosité, sa mobilité, ses contrastes - chef de guerre, poète, érudit, mécène, assassin, fol coureur, (alors que sa femme Isotta est la passion constante de sa vie), assez frivole pour faire bâtir une église où il n’y a que des symboles païens, assez grave pour vivre avec un crâne sur sa table, assez sacrilège pour être condamné au feu par le Saint-Office, assez religieux pour mourir en chrétien - tout cela est dans la chronique et l’histoire : je n’ai rien inventé. (…) Tous les forfaits dont on le voit accusé dans ma pièce, de l’effroyable au cocasse, sont eux aussi historiques. (…) Je ne veux pas dire que ces accusations étaient fondées. Son ennemi acharné Pie II pouvait accuser Malatesta de n’importe quoi, avec autorité (…) Malatesta passe pour quatre fois assassin, et peut-être n’assassina-t-il jamais. Constatation terrible.”
Montherlant va modifier la fin de Malatesta en le faisant mourir empoisonné par son biographe, plutôt que de le faire mourir, comme réellement ce le fut, dans son lit, à cinquante et un ans.
Résumé
“Le Pape Paul II, successeur de Pie II, désirerait envoyer des troupes pontificales à Rimini, la ville de Malatesta. Il offre en échange à Malatesta les cités de Spolete et de Foligno. Furieux de ce qu’ose lui proposer le Pape, Malatesta court à Rome avec l’intention de l’assassiner. Mais arrivé devant Paul II, il se jette à ses genoux. Le Pape pour l’empêcher de nuire, lui confie une charge honorifique au Vatican. Malatesta se morfond à Rome; il tombe malade. Sa femme Isotta, vient de Rimini pour demander sa grâce au Pape, et obtient sa mise en congé. Malatesta retourne à Rimini, mais c’est pour y trouver la mort. Son protégé, le lettré et biographe Porcellio, l’empoisonne.” (Henri Perruchot, Montherlant, Gallimard, p.131).
Citations
Acte I
- “Si les gens savaient tout ce que j’ai fait, pourquoi je n’ai pas été puni et aurais dû l’être, ils verraient alors que c’est l’évidence même que je suis protégé des dieux.” (Malatesta)
- “Le meilleur des gendres est le tombeau.” (Malatesta)
- “C’est un vice chez vous que de chercher à vous rendre odieux, mon seigneur père.” (Camerino, gendre de Malatesta)
- “Grand Dieu, pourquoi ai-je fait tout ce que j’ai fait ? Si j’ai fait tout ce que j’ai fait, depuis cinquante et un ans que je suis sur la terre, et si on me traite ainsi, à la fin de tout ce que j’ai fait, j’ai vécu et j’ai fait pour rien.” (Malatesta)
- “Moi, aussi, je veux quelqu’un qui marche quand je marche, qui s’arrête quand je m’arrête, qui ne s’éloigne pas de trois pas, et qui encore ne laisse jamais paraître qu’à cet état il trouve quelque chose à redire. Voilà les hommes dont j’ai besoin. Non des hommes à beaux-frères et à héritages.” (Malatesta)
- “Vous êtes bien comme les autres : vous m’offrez toujours ce qui ne me fait pas plaisir.” (Malatesta)
- “Nous sommes en vie surtout à cause de la lâcheté des autres.” (Malatesta)
- “Si vous n’êtes pas prêt à tuer ce que vous prétendez haïr, ne dîtes pas que vous haïssez : vous prostituez ce mot.” (Malatesta)
- “Laisse-moi mes folies. Une petite flamme de folie, si on savait comme la vie s’en éclaire ! Et puis si je ne me regardais pas vivre, pourquoi vivrais-je ?” (Malatesta)
- “Si je quitte des yeux un seul instant ceux qui me servent, c’en est fait, ils m’ont trahi. Je marche au milieu des traîtres, comme on marche au milieu des arbres dans une forêt.” (Malatesta)
- “Vivent mes ennemis ! Eux du moins ne peuvent pas me trahir.” (Malatesta)
Acte II
-
“Il vaut mieux passer la nuit avec la colère qu’avec le repentir.” (Malatesta)
Malatesta.
- “Tribunal de justice ? Tribunal d’injustice, comme les autres ! (…) Tribunal de la Légèreté, de la Vengeance et de la Haine. (…) Et d’abord, quiconque accepte de juger son semblable se condamne lui-même. Car il sait bien qu’il est toujours aussi coupable que celui qu’il juge.” (Malatesta)
- “En quelque tribunal qui soit au monde, il suffit de voir les têtes des juges pour savoir que l’accusé est innocent.” (Malatesta)
- “Car tout ce dont vous m’accusez est pure invention et calomnie. On m’accuse de ce que j’ai fait, de ce que je n’ai pas fait, et aussi des mêmes actes pour lesquels on ne blâme pas les autres, quand ce sont eux qui les font, et pour lesquels même il arrive qu’on les loue. On m’accuse de ce dont on me croit capable, et on me croit capable de tout, parce que ce sont mes ennemis qui ont pris le dessus dans la fabrication de ma légende (…) Je suis entouré de haine, d’une haine qui depuis trente-cinq ans n’a pas désarmé (…) La haine ! toujours la haine ! Ah ! comme on aura été infâme avec moi !” (Malatesta)
- “Quand j’ai le ton des héros, on me le reproche. Quand j’ai le ton humain, on me le reproche. Pourquoi ne me plaindrais-je pas une fois ? J’en ai assez d’être toujours de fer.” (Malatesta)
- “Pourquoi me donnerais-je le mal de me tenir droit, puisque de toute façon on affirmera que je suis tordu ? Pourquoi ferais-je quelque chose de bien, puisque ce ne sera reconnu par personne ? C’est ainsi qu’on a corrompu et flétri tout ce qu’il y avait de bon et de fleurissant en moi !” (Malatesta)
Acte III
- “Je n’ai jamais vu d’enthousiasme que pour des causes bêtes.” (Malatesta)
- “Mais j’ai au moins la satisfaction de me dire que je suis coupable. Comme j’ai bien fait de l’être ! Vive ma vie ! Je me console aussi en recherchant dans les auteurs anciens tous les passages où il est question d’hommes illustres qui furent en disgrâce. Ils l’ont été presque tous, Dieu merci; et je finis par me sentir heureux au milieu de cette grande famille de condamnés.” (Malatesta)
- “Il y a en lui, (Malatesta), par instants, quelque chose de désarmé. Souvent ses nerfs de femme; et parfois ses idées d’enfant. Il ne sait pas dissimuler avec persévérance; sa vitalité amère et ingénue le trahira toujours.” (Isotta, épouse de Malatesta, au Pape)
- “Ce qui me dégoûte dans la haine, c’est sa grossièreté : elle accueille n’importe quel bruit, se nourrit de tout, sans examen, sans discernement. Comme elle est bête et rend bête ! Un grand esprit qui hait devient aussi stupide qu’un bouvier.” (Isotta)
- “Plût au ciel que les prêtres aimassent Jésus-Christ autant qu’une femme peut aimer son époux ! Et plût au ciel que ces prêtres eux aussi fussent un peu aimés, et ceux-là mêmes qui siègent sur le trône de Pierre !” (Le Pape)
- “Toute notre vie se passe à ne pas satisfaire les gens.” (Le Pape)
- “Il devrait pourtant y avoir une récompense quand on fait quelque chose de bien; sinon une récompense des autres, du moins une récompense de soi. Mais rien, mon Dieu ! non rien, mon Dieu ! non, rien, mon Dieu ! pour l’honnêteté. Ou plutôt si, une punition…” (Le Pape)
Acte IV
- “Pourquoi est-on si sévère pour la peur ? Ce que nous craignons finit toujours par arriver.” (Isotta)
- “Je me sens plus à mon aise lorsqu’on m’insulte que lorsqu’on me loue.” (Malatesta)
- “Un être que l’on aime est toujours en danger.” (Isotta)
- “Depuis que j’existe, j’ai été entouré, préservé, soutenu, vivifié par les femmes.” (Malatesta)
 |
|
|
Pape Paul II. |
Analyse
Pour moi, le texte de cette pièce est un des plus admirables écrits par Montherlant pour le théâtre. Tout est contrôlé, tout brûle d’un feu qui n’incendie pas, un feu intérieur, retenu. Il y a dans cette pièce une tension incroyable. Malatesta, homme d’action et de guerre, est immobilisé par le Pape dans le Vatican, pour éviter de nuire. Lui qui est un emporté, un audacieux, ronge alors son frein, s’affaiblit et tombe malade.
Isotta, son épouse, qui l’aime tendrement, malgré ses infidélités, vient à Rome pour négocier avec le Pape la libération de son époux Malatesta, non pas comme une humble servante, mais en s’adressant au Pape avec audace, n’hésitant pas à l’attaquer, à le bousculer, en lui montrant que lui aussi, Paul II, a des défauts, des susceptibiliés, et qu’il est aussi, comme Malatesta, victime de calomnies de la part du public.
“On dit que vous passez chaque jour une heure à vous farder le visage…”
Paul II est pétrifié.
“A me farder ! Avez-vous entendu cela ? Mais madame Isotta, vous ne l’avez pas cru n’est-ce pas ? Quelle démence ! Ainsi voilà quatre ans qu’au prix d’une peine infinie et de tous les instants je défends la doctrine de l’Eglise, et là-dessus je n’ai jamais faibli (…) Et tout cela pour qu’on dise seulement que le Souverain Pontife se peint le visage. Est-ce que ce n’est pas horrible ?”
Elle parvient à se concilier le Pape ému par son courage et à faire revenir Malatesta à Rimini. Ce qu’Isotta et Malatesta réunis à nouveau à Rimini n’ont pas prévu, c’est la trahison du fidèle confident, le lettré-biographe Porcellio. Celui-ci fut sauvé de la mort par Malatesta, mais il ne supporte pas de lui être redevable ni de lui témoigner de la reconnaissance.
“Parce qu’il m’a sauvé la vie une fois, dois-je user mon temps et ma peine à le ménager, à le caresser, à être pour lui aux petits soins, toute cette vie ? Dois-je me gêner pour lui toute ma vie ? Dois-je payer toute ma vie ? (…) Oui, je l’affirme, il vaut mieux ne pas vivre, que vivre emprisonné et empoisonné par des devoirs de gratitude. A quoi bon recevoir, s’il faut rendre. La prochaine fois qu’on voudra me tuer, eh bien ! je me laisserai tuer plutôt que d’entrer dans l’enfer de la reconnaissance.” (Acte IV, scène VI).
Le biographe qui avait la confiance de Malatesta lui versera du poison dans son vin pour ne plus avoir à lui manifester de la reconnaissance. Et devant les yeux de Malatesta, agonisant et horrifié par cette traîtrise, Porcellio lacère et jette au feu les pages de l’unique exemplaire de la Vie de Malatesta qu’il rédigeait pour lui depuis des années, énumérant tous les hauts faits du Prince de Rimini.
Comment ici ne pas penser à tous ces écrivains et critiques, muscadins, barbons littéraires, assassins de lettres, lanceurs de mots et de mode, journalistes à l’affût de scandales, et même le fade d’Ormesson, dans son Histoire de la littérature française, sans intérêt aucun, ou Yourcenar, qui du vivant de Montherlant s’agenouillait devant lui, dans sa correspondance (!), en lui servant du “Cher Maître” et qui, après le suicide, quand il fut bien mort, écrit en avril 1976 à Jeanne Carayon : “J’en veux à Montherlant d’avoir été si inférieur à sa propre grandeur” (la belle hypocrite !), et tous ceux qui ont tourné le dos à Montherlant, à la fin de sa vie ou après sa mort, qui n’ont pas voulu le défendre quand il fut attaqué par des chacals, et qui, brusquement, après des dizaines d’années où ils le portèrent aux nues, pensèrent que l’illustre Montherlant devait être plongé dans les oubliettes. Alors qu’au sommet de sa gloire, ils lui quémandaient un peu de son ombre pour un article, un livre, une visite, une interview ou une rencontre, ou bien même pour faire vivre leurs enfants grâce à l’argent gagné par leurs écrits sur l’œuvre de ce génie.
Plus encore, certains de ses amis l’assassinèrent de leur silence quand il fut outragé. Montherlant l’avait prévu.
Porcellio le traître, le serpent ! (Acte IV, Scène X)
 |
 |
|
|
Eglise et tombeau de Malatesta à Rimini en Italie. |
||
Octobre 1947, Montherlant séjourne à Rome avec Mathilde Pomès
Ils se connaissent depuis 1926. Elle est traductrice d’auteurs espagnols comme Gomez de la Serna, Unanumo, Guzman, Ortega y Gasset, et a publié à Paris des recueils de poèmes. Ils descendent à l’hôtel Minerva, bien connu de la famille de Montherlant, car le grand-père maternel, le Comte Emmanuel de Riancey, zouave pontifical, y avait vécu du temps de son service pour la Papauté. Chacun a sa chambre. Avec Mathilde Pomès, Montherlant va parcourir le Forum, visite le Capitole, le musée du Vatican, la Chapelle Sixtine où il s’attarde. Il juge le Vatican très laid, et le Forum - où ses cendres seront en partie dispersées en 1972 - très resserré.
Voici comment Mathilde Pomès décrit Montherlant, son compagnon de voyage :
“Il s’est fait fendant et il est timide, superbe et il est simple, intraitable ou tout au moins désagréable et il est facile. Avec des bris et des éclats, imprévisibles et sans motif, ou quelque motif puéril et alors violent, emporté et, pis encore, un ton souffletant qui fait voir rouge à celui qui l’endure. La pierre angulaire de son caractère, le fondement congénital, inébranlable : l’impatience au sens étymologique. Lui-même se dit nescius tolerandi. Ou d’autres fois, écorché. Impossible de supporter quoique ce soit : étourderie, minute d’attente, maladresse. Et lui-même parfois étourdi et presque constamment maladroit, exerçant à tout propos la patience des autres. Aucun sens du plain-pied, toujours en décalage, plus haut et plus bas. Nulle humeur quand il se sent plus bas, mais une façon hautaine d’ôter toute importance à ce bas. Par exemple, à propos de fautes d’orthographe, il avoue très simplement : “Je ne sais pas ces choses-là, mais le ton signifie : “c’est affaire de cuistres” (…) Jamais plus charmant que lorsqu’apprivoisé, il se laisse aller à des gestes un peu familiers ; se servir un second verre de fine, reprendre, le repas achevé, un fruit dont il a encore envie. Il retrouve alors cet air si jeune qui m’a d’abord séduite et vous regarde avec une demi-espièglerie d’enfant qui veut dire : “Ce n’est pas bien, mais je le fais parce que je sais que je ne serai pas grondé.” Lui, dont j’ai pu vérifier à plusieurs reprises, la scrupuleuse, voire vétilleuse probité, s’embarrasse de fétus. Pas débrouillard, ne sachant pas y faire pour un sou (…) la roublardise, n’en parlons pas ; elle est pour lui synonyme de bassesse. Et tout ce qui est bas lui tire le sang : cheval de race qu’une mouche pique. Le sens de ce qui est noble; du noble et du grand de préférence au beau. Observation toujours en éveil, prompte et vive (…) Son extrême sévérité pour les femmes, son horreur des fards, des cheveux teints, des ongles faits. Voilà la liberté de ce garçon - jamais je ne pourrai pour lui, dire homme - si libre ; voilà la licence de cet écrivain prétendu licencieux ; le code le plus strict d’habitudes et de façons d’être de sa caste, une caste étroite de goûts et d’idées, mais pour qui ce qui sied et ce qui messied, la canaillerie et l’honnêteté, la décence et l’indécence ne se pénétraient point ni ne se confondaient comme pour la caste des intelligents et des malins qui lui a succédé.” (Mathilde Pomès, A Rome avec Montherlant, p.153-160).
A noter : l’emploi fréquent chez lui du mot “indécence”.
Elle écrira encore un livre paru en 1934 Deux aspects de Montherlant, où elle étudiera le goût de Montherlant pour l’Espagne et sa poésie.
1945, Le maître de Santiago (publié en 1947)
Pièce en trois actes créée au Théâtre Hébertot le 26 janvier 1948. Reprise à la Comédie française en 1958. Elle fut projetée à la Télévision française en 1955.
Résumé
La scène se passe en Castille, à Avila, en 1519. Don Alvaro, le Maître de l’ordre de Santiago, aime Dieu exclusivement. Il a une fille, Mariana, amoureuse de Jacinto, fils d’un des chevaliers de l’ordre, don Bernal. Celui-ci propose au Maître de Santiago de partir pour les Indes afin de s’enrichir ce qui faciliterait le mariage, vu la pauvreté des deux familles nobles.
“Il faut que Jacinto épouse une fille riche (…) Allez passer seulement deux ans, seulement un an, au Nouveau Monde, vous en revenez riche (…) et comme s’il vous tombait du ciel, l’or afflue entre vos mains”, dit don Bernal à Alvaro. Don Alvaro refuse catégoriquement de partir. “Tout ce qui a trait au Nouveau Monde est impureté (…). Des conquêtes de territoires ? Cela est tellement puéril… Et tellement absurde. Vouloir changer quelque chose dans des territoires conquis, quand il est si urgent de réformer la patrie elle-même, c’est comme vouloir changer quelque chose dans le monde extérieur quand tout est à changer en soi.” Pour le faire céder, on lui monte une comédie. On lui envoie le comte Soria, un pseudo-émissaire du Roi, pour lui faire croire que le Roi souhaite qu’il aille dans le Nouveau Monde, car “Sa Majesté a compris que l’évangélisation des Indiens, faite en majeure partie par des aventuriers, était chose impossible” : il sera donc un exemple d’intégrité dans un milieu corrompu. Don Alvaro est prêt à céder. Mais Mariana, sa fille, partagée entre son amour pour Jacinto et son amour pour son père, apparait et dévoile la supercherie à son père. Le mariage ne se fera pas. Mariana veut préserver l’intégrité de son père. “Mariana est sacrifiée à l’idée que son père Alvaro se fait de l’honneur et de la sainteté.” (Perruchot).
Après une grande scène mystique entre le père et sa fille, tous deux décident de se retirer dans un couvent.
La troupe de Jacques Hébertot donna, dès la création, plus de 800 représentations de ce drame. La première fut une des “grandes premières” de Montherlant, comme celle de La Reine morte, de Port-Royal et du Cardinal d’Espagne.
Critiques
Voici la critique de Thierry Maulnier en 1947, dans Hommes et Mondes :
“Le Maître de Santiago porte hautement le témoignage de ce que Montherlant est l’un des plus grands écrivains français de ce temps. Il y a dans ces trois actes une force qui les soutient sans défaillance à une singulière hauteur.”
 |
|
|
Julien Green. |
Julien Green écrit dans son Journal le 3 février 1948 :
“Ce chef d’œuvre étrange, écouté dans le plus profond silence par un public qui a oublié d’applaudir au baisser du rideau, pendant plusieurs secondes, d’étonnement. J’ai été moi-même abasourdi. Entendu dire beaucoup de sottises sur Montherlant et, en particulier, sur cette pièce. Que leur faut-il donc ? Je ne comprends pas qu’ils ne sachent pas au moins garder le silence devant une œuvre d’une telle beauté, beauté irritante peut-être, exaspérante même, parce que l’auteur avec tout son génie, touche à des choses très graves avec une sort d’insolence qui fait peur.” (Journal, t.V, 1951).
 |
|
|
Daniel-Rops. |
L’avis de Daniel-Rops :
“Au milieu d’une production théâtrale dont le plus évident caractère d’ensemble est la platitude, un manque de style affligeant, il y a quelque chose de réconfortant à trouver ici ce ton royal, cette aisance insolente et cette merveilleuse utilisation des possibilités infinies de la langue (…) Montherlant, un écrivain dont on ne voit pas qu’il ait son égal de nos jours.” (La Bataille, janvier 1948).
Jean Cocteau écrira en 1950 :
“Montherlant, c’est l’aigle à deux têtes. L’une de ces têtes est la tête de Malatesta, l’autre est celle du Maître de Santiago.”
Citations
Acte I
- “Pour mon père, seul est important, ou plutôt seul est essentiel, ou plutôt seul est réel ce qui se passe à l’intérieur de l’âme.” (Mariana)
- “Roule, torrent de l’inutilité !” (Alvaro)
- “Je n’ai soif que d’un immense retirement.” (Alvaro)
- “J’aime d’être méconnu.” (Alvaro)
- “Nous perdrons les Indes. Les colonies sont faites pour être perdues. Elles naissent avec la croix de mort au front.” (Alvaro)
- “Le Nouveau Monde pourrit tout ce qu’il touche.” (Alvaro)
- “Je n’ai rien à faire dans un temps où l’honneur est puni, - où la générosité est punie, - où la charité est punie, - où tout ce qui est grand est rabaissé et moqué, - où partout, au premier rang, j’aperçois le rebut, - où partout le triomphe du plus bête et du plus abject est assuré. Une reine, l’Imposture, avec pour pages le Vol et le Crime, à ses pieds. L’Incapacité et l’Infamie, ses deux sœurs se donnant la main. Les dupeurs vénérés, adorés par leurs dupes…” (Alvaro)
- “J’en ai assez. Chaque fois que je pointe la tête hors de ma coquille, je reçois un coup sur la tête.” (Alvaro)
- “Je suis fatigué de ce continuel divorce entre moi et tout ce qui m’entoure. Je suis fatigué de l’indignation. J’ai soif de vivre au milieu d’autres gens que des malins, des canailles, et des imbéciles. Avant, nous étions souillés par l’envahisseur. Maintenant, nous sommes souillés par nous-mêmes; nous n’avons fait que changer de drame.” (Alvaro)
- “La pureté, à la fin, est toujours blessée, toujours tuée, elle reçoit toujours le coup de lance que reçut le cœur de Jésus sur la croix.” (Alvaro)
- “Moi mon pain est le dégoût. Dieu m’a donné à profusion la vertu d’écœurement. Cette horreur et cette lamentation qui sont ma vie et dont je me nourris…” (Alvaro)
- “Il ya encore des monstres. Jamais il n’y en a eu tant. Nous en sommes pressés, surplombés, accablés. Là… là… là… Malheur aux honnêtes ! Malheur aux honnêtes ! (…)” (Alvaro)
- “Malheur aux honnêtes…Malheur aux meilleurs…” (Alvaro)
- “Jeunesse : temps des échecs.” (Alvaro)
Acte II
- “Tant de choses ne valent pas d’être dites. Et tant de gens ne valent pas que les autres choses leur soient dites. Cela fait beaucoup de silence.” (Alvaro)
- “Les attachements me déplaisent.” (Alvaro)
- “Tout être humain est un obstacle pour qui tend à Dieu.” (Alvaro)
- “Votre chevalerie vous égare. Vous êtes un de ces esprits charmés de leurs propres rêves, qui peuvent devenir si dangereux pour une société.” (Don Bernal)
- “J’ai été élevé à apprendre qu’il faut volontairement faire le mauvais marché. Qu’il ne faut pas se baisser pour ramasser un trésor, même si c’est de votre main qu’il s’est échappé. Qu’il ne faut jamais étendre le bras pour prendre quelque chose. Que c’est cela, et peut-être cela plus que tout, qui est signe de noblesse.” (Alvaro)
- “Je ne tolère que la perfection.” (Alvaro)
- “Il n’y a de famille que par l’élection et l’esprit; la famille par le sang est maudite.” (Alvaro)
- “Nous de l’Ordre, nous sommes une famille…” (Alvaro)
A sa fille Mariana dont il apprend l’amour qu’elle porte au fils de Don Bernal :
- “On me dit que vous avez pris je ne sais quel sentiment pour le fils de don Bernal. Et vous avez cela dans une pièce de ma maison, à quelques pas de moi ! Sachez que j’ai horreur de ce genre. Bien entendu, vous croyez que vous êtes seule au monde à aimer, que vous comprenez l’univers, etc. Cependant qu’est-ce que vous êtes ? Vous êtes une petite singesse, rien de plus. Et tout cet amour entre hommes et femmes est une singerie. Sachez que vous êtes enfoncée en pleine grimace, en plein ridicule, et en pleine imbécillité.” (Alvaro)
- “Je veux entrer dans le mariage, et refermer la porte comme on fait quand on est entré dans un oratoire, et ne plus regarder derrière moi, jamais. Il sera le seul pour moi, et je serai la seule pour lui. Perdue en lui seul pour toujours.” (Mariana)
Acte III
- “Le parfait mépris souhaite d’être méprisé par ce qu’il méprise, pour s’y trouver justifié.” (Alvaro)
- “Que voulez-vous qu’on méprise quand tout est déshonoré ?” (Alvaro)
- “Laisse-moi t’entraîner dans ce Dieu qui m’entraîne. Bondis vers le soleil en t’enfonçant dans mon tombeau.” (Alvaro à sa fille)
- “C’est en ne voulant rien que tu reflèteras Dieu.” (Alvaro à sa fille)
Il ne faut pas oublier que Montherlant a écrit cette pièce en 1945, période où il subit les pressions de certains qui lui demandent pourquoi il n’a pas “résisté” durant la guerre. Les tourments de Montherlant à la fin de la guerre se reflètent dans le personnage d’Alvaro. Fuir le monde, ne plus agir, renoncer, se purifier.
Le climat de cette pièce est sombre. Alvaro, le Maître de Santiago se détache d’un monde qu’il trouve abject, comme le jeune Montherlant de 1919 trouvait le monde de la paix abject, et créait, lui aussi, un Ordre avec quelques amis. C’est comme si Montherlant dans cette pièce décrivait la fin de “son” Ordre, que le Maître de Santiago ne parvient pas à rénover. Bien plus, Alvaro accélère cette fin, parce qu’il est trop intolérant, parce que, comme le dit don Bernal :
“Votre chevalerie vous égare. Vous êtes un de ces esprits charmés de leurs propres rêves, qui peuvent devenir si dangereux pour une société.” (Acte II, Scène I)
En 1919, Montherlant avait mis fin à l’Ordre, après 10 mois d’existence car l’atmosphère survoltée était devenue irrespirable à cause de Montherlant lui-même (voir dans Biographie la section Le Voyageur). Ce thème de l’Ordre dans l’œuvre de Montherlant est très intéressant à étudier, mais ce n’est pas l’endroit ici. Même cercle très restreint de “purs”, même mépris pour les compromissions, pour les amours, pour l’argent et les biens matériels. Alvaro ne tolère que la perfection. Il est tendu vers Dieu, mais son manque de compassion pour sa fille, notamment, pourrait faire croire qu’il se cherche d’abord une attitude, qui est la haute idée qu’il se fait de lui-même.
“Je n’ai que l’idée que je me fais de moi-même pour me soutenir sur les mers du néant.” (Carnets)
Le Roi Ferrante dans La Reine morte, Alvaro dans le Maître de Santiago et Georges Carrion dans Fils de personne sont comme trois frères. Même vision sombre de la vie, même mépris pour ce qui est médiocre ou vulgaire, même retraite dans une solitude blessée, méprisante, même absence de tendresse pour les petits, même dédain pour les amours qui sont pour eux singerie, grimace, ridicule et imbécillité.
“Cette horreur et cette lamentation qui sont leur vie et dont ils se nourrissent !” (Le Maître de Santiago, Acte I).
Ils arrivent dans cet état, car ils sont percés de flèches, ensanglantés eux-mêmes sous les coups reçus, abreuvés d’outrages… “J’en ai assez. Chaque fois que je pointe la tête hors de ma coquille, je reçois un coup sur la tête.” Dit Alvaro, dans l’acte I.
 |
|
|
Montherlant vu par Pierre-Yves Trémois |
Tous les trois font souffrir ceux qui les entourent incapables de respirer à la hauteur où ils respirent, et comme Abraham, sacrifient leur fils (Pedro pour Ferrante et Gillou pour Carrion) ou leur fille (Mariana pour Alvaro), à l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes. Pas de pitié ! Il faut suivre, sinon “en prison pour médiocrité !”. Alvaro à sa fille :
“Vous me blessez au plus sensible. Je m’efforce de mener une vie un peu haute. Et c’est vous qui me perdez ! Vous, qui devriez me soutenir, c’est vous ma pierre d’achoppement !” (Acte II, Scène II).
Ces caractères sont tendus vers un idéal inatteignable. Leurs enfants sont des poids. Un homme marié est un homme perdu.
Ces trois personnages de ténèbres, Ferrante, Alvaro, Carrion, sans le secours d’un fils ou d’une fille, moins encore d’une épouse absente, morte ou maîtresse déchue (les épouses dans l’œuvre de Montherlant sont des personnages, soit ridicules, Madame Dandillot ou Madame Auligny, soit folles comme Jeanne la Folle dans Le Cardinal d’Espagne), sont seuls, totalement seuls avec leur idéal qui les épuise, et qui est quasi inhumain. Chez ces trois “frères” sombres comme la nuit, on ne trouve pas de joie. Le monde est corrompu. Ils cherchent la pureté qu’ils ont perdue, et ils ne la trouvent plus que sur quelques visages innocents.
A cela, Montherlant répond : “Lisez l’Ancien Testament, l’Ecclésiaste, les paroles de l’Ecriture, les auteurs sacrés ! Ils parlent comme Alvaro”.
Et Montherlant dans les notes de son Théâtre, (Pléiade, p.537, Le blanc est noir), va citer des dizaines d’extraits pris dans la source de la Tradition chrétienne, qui font scandale pour le public chrétien du XXe siècle.
Je citerai un seul des nombreux textes que Montherlant présente pour justifier le caractère authentiquement chrétien du Maître de Santiago :
“(…) Nul ne peut servir deux maîtres. Le désir qu’a votre mère de vous conserver auprès d’elle est contraire à votre salut ; il l’est également au sien. Il ne vous reste plus qu’à choisir : ou de faire la volonté d’une personne aimée, ou de faire le salut de deux âmes. Si vous l’aimez vraiment, vous la quitterez plutôt pour l’amour d’elle-même, de peur que, si vous quittez le Christ pour rester auprès d’elle, elle ne se perde elle-même (…) Car la parole de Dieu est formelle et ne permet aucun compromis : s’il est impie de mépriser sa mère, le comble de la piété, c’est pourtant de la mépriser pour le Christ, car…“Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi (Matthieu, X, 37).” (Extrait d’une lettre de Saint Bernard à Gautier de Chaumont, lettre 104).
Et Montherlant de conclure :
“Il est stupéfiant que des catholiques ne reconnaissent pas un des visages certains de leur religion dans celui que leur présente Le Maître de Santiago. Ou plutôt cela n’est pas stupéfiant, si je me souviens qu’ayant un jour cité les deux paroles suivantes : “Doctrine de l’Evangile, que vous êtes sévère !” et “L’œuvre de Dieu est une œuvre de mort et non de vie”, à un catholique pratiquant et militant, il sursauta et me dit avec indignation : “Je reconnais votre jansénisme !”, alors que la première de ces paroles est de Bossuet, et la seconde de Fénelon.”
Pour Montherlant, le vrai chrétien est l’homme sans compromis avec le mal.
1949, Demain il fera jour
Drame très court, en trois actes, créé au Théâtre Hébertot le 9 mai 1949, à lire et à jouer comme la suite de Fils de personne.
“J’ai toujours arrêté mes pièces à temps, note Montherlant. Je veux dire : avant l’acte final, celui que je n’ai pas osé écrire. Une fois seulement, j’ai écrit cet acte final : Demain il fera jour est l’acte final de Fils de personne. Et, complété par lui, Fils de personne devient tout à coup la plus profonde, la plus tragique et la plus mal comprise de mes pièces.” (Perruchot, Montherlant, NRF, p.132).
Résumé
Quatre années après leur séparation à Cannes qui eut lieu dans l’hiver 1940 dans Fils de personne, la scène se passe maintenant en juin 1944 à Paris, où Georges Carrion retrouve pour la seconde fois son fils Gillou (17 ans) et la mère de Gillou, Marie. Gillou désire s’engager dans la Résistance. Carrion oppose à ce projet toutes sortes de raisons. La mère qui aime tendrement son fils partage l’avis de Georges. Mais Georges, avocat d’affaires, a entretenu des relations avec les Allemands, et il craint d’avoir des ennuis à la Libération. Il a peur. Il reçoit des lettres de menace. Aussi va-t-il lever bientôt l’interdiction faite à Gillou, et l’autoriser à devenir un résistant, à la grande frayeur de la mère qui pressent la catastrophe. L’attitude de Georges est méprisable car il cherche d’abord à se couvrir. Cependant, il recommande fortement à Gillou de ne pas prendre de risques exagérés, ce qui fait sourire Gillou, ne se voyant pas dire à ses futurs chefs :
“Ce risque-là, je ne puis le prendre. Ah ! non, cela, c’est un peu trop. Mon papa me l’a défendu”. J’aurais plus honte d’être de la Résistance dans ces conditions-là, que de n’en être pas du tout.” (Acte II, Scène IV)
Mais Gillou est tué, sacrifié ainsi pour la seconde fois par son père.
Au théâtre
L’idée de Jacques Hébertot était de convaincre Montherlant d’écrire la suite de Fils de personne. C’était un défi très difficile. Car donner Demain il fera jour en spectacle séparé, sans que le spectateur connaisse l’épisode de Fils de personne risquait de rendre cette pièce incompréhensible. Et donner les deux pièces l’une à la suite de l’autre, cela voulait dire sept actes de suite pour le spectateur ! De plus, dans la première pièce, Gillou a 14 ans, et dans la seconde il est un jeune homme de dix-sept ans. Le rôle de Gillou ne pouvait donc être joué par le même acteur.
Montherlant néanmoins accepta le défi. Mais il a reconnu ensuite que :
“Demain il fera jour fut au théâtre un échec, car (…) les problèmes “collaboration-résistance” gênaient une partie du public, (…) la pièce n’était pas nourrie suffisamment, (…) et le renversement des caractères déconcertait le public : or, déconcerter le public est, paraît-il, impardonnable.”
Michel de Saint Pierre a consacré son livre Montherlant bourreau de soi-même (Gallimard) à ce drame. Il l’analysa avec profondeur ainsi que les raisons de son insuccès.
Evolution des personnages dans Demain il fera jour par rapport à Fils de personne
Dans Fils de personne, Georges, le père, très cassant, autoritaire, impatient, écrase Gillou de ses reproches. Motif : Gillou, 14 ans, s’intéresse uniquement à ce qui est vulgaire. Il fait honte à son père.
Dans Demain il fera jour, le personnage de Georges se tasse, vieillit ; il est lui-même accroché par des histoires de collaboration, il craint d’être arrêté ou assassiné. Il pense d’abord à lui. Il espère se dédouaner face aux Résistants s’il autorise son fils (qui le lui demande !) à entrer, en juin 1944, dans la Résistance. Mais Georges ne veut pas que Gillou prenne des risques trop importants ! Ce qui est irréaliste une fois la décision prise…
On ne punira pas le père d’un résistant, voilà la pensée secrète du père, et il se fait horreur d’agir ainsi, mais il laisse son fils partir vers un risque peut-être mortel. Il aime toujours son fils, quoiqu’il en dise. Quand Gillou lui confie qu’il recevra une arme, Georges est horrifié. Il ne pensait pas en donnant sa permission, que Gillou serait si vite exposé à la mort. Trop tard, il ne peut plus reculer.
“Alors, au revoir, mon petit.” (Acte II, Scène IV)
Georges ne correspond plus à la haute idée qu’il voulait donner de lui-même dans la première pièce.
Marie, la mère, qui dans Fils de personne est un personnage assez superficiel, en manque d’amour, en manque d’homme, doit composer avec Georges, le père de son fils Gillou, car elle dépend de lui financièrement. Elle est une créature faible, allant de Georges à Gillou, et de Gillou à Georges, manœuvrant Gillou pour qu’elle puisse rejoindre Le Havre et retrouver un amant.
 |
|
|
Demain il fera jour, 1949. |
Dans Demain il fera jour, son personnage prend de l’épaisseur et de l’allure. Elle a perdu son amant du Havre et a reporté toutes ses affections sur Gillou qui a 17 ans. Elle veut le protéger, mais envisage d’abord de laisser Gillou s’engager dans la Résistance pour lui faire retrouver sa bonne humeur. Ensuite un rêve sinistre à propos de Gillou lui fait changer d’avis, et elle supplie Georges de lui interdire d’entrer dans la Résistance, ce que Georges accepte. Mais Georges, après réflexion, va aussi changer d’avis ! Effrayé à l’idée d’être poursuivi pour faits de collaboration, et objet de menaces, il autorise enfin Gillou à entrer dans la Résistance. Marie, consciente du péril couru par son fils, est folle d’anxiété, et elle réalise que Georges, dominé par sa peur, est prêt à sacrifier son fils. A la dernière scène, on voit Georges et Marie inquiets d’un important retard de Gillou. Georges essaie de la rassurer, mais il est troublé. Marie comprend qu’à sa première mission, son fils sera tué, elle crie à Georges :
“Misérable ! Je vois ton visage. Maintenant je sais pourquoi tu lui as permis de partir (…) Misérable ! Misérable ! (…) Lâche quand tu l’as abandonné à sa naissance. Lâche quand tu l’as abandonné à Cannes (en 1940). Lâche et hideux quand tu viens de le tuer, pour te sauver toi-même…”
Gillou, le fils, est assez bébète à 14 ans dans Fils de personne et il est incapable de répondre à un père trop intelligent, trop rigide, autoritaire, qui voudrait que son fils soit d’un haut niveau intellectuel et moral ! Gillou se réfugie dans des jeux idiots et des illustrés. Il aime son père comme il aime sa mère, et ne veut pas se compliquer la vie.
Dans Demain il fera jour, Gillou a 17 ans, et pour son père, il est devenu indifférent, il est toujours un médiocre. Mais il s’est décidé à agir, à sortir du milieu familial. Il veut s’émanciper.
“Il fait ce que fait un garçon généreux qui n’a pas grand chose d’autre à offrir : il offre sa vie.” (Postface de Montherlant, Théâtre, Pléiade, p. 593).
Gillou a trouvé une “qualité” que Georges lui refusait dans Fils de personne. Cette “qualité” le mènera à la mort, tandis que son père si sûr de lui dans la première pièce, s’effondre dans la deuxième, puisqu’il livre en quelque sorte son fils à la mort pour essayer d’échapper à l’épuration.
Laissons le dernier mot à Montherlant :
“Avec Demain il fera jour j’ai fait un bond, plus haut encore dans la solitude, comme un ballon qui jette du lest.” (Théâtre, Pléiade, p. 599).
Et ceci :
“En publiant cette pièce, j’ai cédé à une dernière tentation : celle de faire ce que la plupart des auteurs ne feraient pas. Sortir de sa tranquilité pour appeler sur soi le taureau, du pied, du cri et de la cape, c’est une tentation qui revient périodiquement dans ma vie.” (Théâtre, Pléiade, p. 597).
Montherlant dût, en effet, connaître à la fin de la guerre un état de grande tension : l’anxiété de vivre en prison, isolé, dans l’attente de procédures, à la merci du premier venu, ou de juges fanatiques, revanchards aux ordres du nouveau Pouvoir, la peur d’être assassiné par des inconnus qui auraient voulu l’“épurer” par l’assassinat etc… L’ imagination de Montherlant devait l’envahir d’hypothèses sinistres. “Le pire est toujours certain”.
Toute cette atmosphère de fin de guerre et de règlements de compte se reflètent dans l’ inspiration des drames écrits lors de ces années. Montherlant est persuadé que ses ennemis cherchent à le mettre en difficulté. Mais il est de bonne foi, il ne fut pas un collaborateur ! Au contraire, il avait lancé avec véhémence ses mises en garde aux Français en 1938 face à l’Allemagne, il fut un des rares intellectuels à se dresser contre les Accords de Munich, mais sa colère prêchait dans le désert. Il estima avoir fait son devoir. On ne voulut pas l’écouter. Trop tard ! “Malheur aux honnêtes !” Malheur à lui, Montherlant, que les Français et leurs dirigeants n’ont pas écouté à cette époque d’avant-guerre !
Si les procédures lancées contre lui n’aboutirent pas, s’il n’y eut aucune suite judiciaire, cette menace d’être traîné devant des tribunaux où il aurait dû se justifier, fut trop forte pour son tempérament nerveux, sensible, imaginatif et perfectionniste… Il n’oubliera jamais cette sombre époque et prendra ensuite ses distances vis-à-vis de la société civile. Il restera marqué par cette période jusqu’à ses derniers jours. “Malheur aux honnêtes ! Malheur aux honnêtes !” Que de fois a-t-il cité cette parole de Lyautey : “Je meurs de la France !” Montherlant répétait souvent que s’il mourait, ces mots seraient les derniers pour lui. Telle fut la profondeur de sa blessure. Mourir de la France ! On comprend mieux son attitude envers l’Académie Française. Il est sollicité depuis 1947 de s’y présenter. Il répond qu’il ne posera jamais sa candidature, mais, si l’Académie l’élisait sans qu’il eût posé sa candidature, il remplirait, après cette élection, tous les devoirs qui sont d’usage. Il sera élu en 1960 ! Et il n’aura pas fait acte de candidature ! Cas rarissime… Il ne voulait plus rien demander. Ne rien devoir. Rester libre.
“Il ne faut jamais étendre le bras pour prendre quelque chose. Que c’est cela, et peut-être cela plus que tout, qui est signe de noblesse.” (Le Maître de Santiago).
Ne rien devoir à la société civile. Faire l’œuvre écrite. Aimer. Et quand sa santé ne lui permettra plus d’écrire et d’aimer, il restera la mort !
“Fermez-vous, Portes éternelles ! Je n’ai rien à faire dans un temps où l’honneur est puni, – où la générosité est punie, – où la charité est punie, – où tout ce qui est grand est rabaissé et moqué, – où partout, au premier rang, j’aperçois le rebut, – où partout le triomphe du plus bête et du plus abject est assuré. Une reine, l’Imposture, avec pour pages le Vol et le Crime, à ses pieds. L’Incapacité et l’Infamie, ses deux sœurs se donnant la main. Les dupeurs vénérés, adorés par leurs dupes…” (Alvaro, dans Le Maître de Santiago).
1950, Celles qu’on prend dans ses bras
Pièce en trois actes, publiée en 1950, représentée au théâtre de la Madeleine le 20 octobre 1950, avec Victor Francen et Gaby Morlay. Cette pièce sera reprise en 1957 au Théâtre des Ambassadeurs, avec Victor Francen dans le personnage de Ravier. Victor Francen est très apprécié de Montherlant comme acteur. Il jouera ce drame pendant une dizaine d’années tant en France qu’à l’étranger.
“Victor Francen a la stature et le port des héros tragiques. Sa bouche reste ouverte dans la douleur comme les bouches de masques grecs. Il voit ses spectres avec l’œil fixe d’Oronte.” (Montherlant)
Résumé
“Trois personnages dans cette pièce : Ravier l’antiquaire, 58 ans, épris d’une jeune fille de 18 ans, Christine Villancy, qui lui résiste. La collaboratrice de l’antiquaire, Mlle Andriot, sorte de réplique d’Andrée Hacquebaut, (voir Les Jeunes Filles, biographie 1937), l’aime en secret et jalouse Christine. Montherlant nous décrit la passion de Ravier : pleine de fougue, d’amertume et de lucidité. Un service important que Ravier rend à Christine lui livrera la jeune fille. “Tu mens ! Tu es fausse. Tes yeux mentent, ton corps ment, toutes les papilles de ta peau mentent. Tu n’es pas à moi, tu ne me donnes rien, tout est faux dans ce que nous faisons en ce moment.” Ravier sans illusions s’abandonne à son désir.” (Perruchot, Montherlant, NRF, p.133).
 |
|
|
Montherlant vers 1950. |
En exergue de sa pièce, Montherlant cite un extrait de son livre Pitié pour les femmes :
“Voyez-vous, il n’y a qu’une façon d’aimer les femmes, c’est d’amour. Il n’y a qu’une façon de leur faire du bien, c’est de les prendre dans ses bras. Tout le reste, amitié, estime, sympathie intellectuelle, sans amour est un fantôme cruel, car ce sont les fantômes qui sont cruels; avec les réalités on peut toujours s’arranger.” (Costals à Solange, Pitié pour les femmes).
Voici ce qu’écrit le philosophe Manuel de Dieguez à propos de cette pièce (extrait de son article paru dans Combat du 7 décembre 1950) :
“Quoi de plus courant que cette intrigue : un homme aime une femme qui ne l’aime pas, tandis qu’il est aimé d’une femme qu’il n’aime pas. Un peu plus, on se croirait en plein vaudeville, avec une histoire d’amour bien émouvante. Nous avons tellement perdu le goût de la simplicité, que nous trouverions cela trop facile et indigne d’un grand auteur. Mais il n’est pas besoin de solliciter les textes : la solitude atroce où se débattent tous les personnages, la haine qui crève soudain la trame du grignotement quotidien (“Moi aussi j’ai sept ans de haine qui ont leur mot à dire” : Ravier à Mlle Andriot), le côté si burlesque qui surgit comme le fou dans les pièces de Shakespeare - scène de la bergère, - cet arrière-plan, enfin, d’une ville de lucre et de stupre, d’un Paris présenté comme un coupe-gorge (et qui semble l’arrière-plan indispensable aux chefs-d’œuvre de la littérature érotique en France), tout cela, on le devine, recouvre un thème plus secret, qu’il s’agit de mettre à jour (…)”
“Ravier est abondamment fourni en maîtresses; lui aussi proclame qu’il n’y a rien en dehors du plaisir. Et il revient sans cesse sur ce thème déjà cher à Costals : Il n’y a que la possession, il est vain de viser au-delà de l’homme. Pourtant, quelque chose nous avertit de l’échec, ne serait-ce que cette mystique de la chute, cette croyance à la souillure par l’acte de chair (“Je t’aimais innocente, je t’adorerai corrompue”), qu’on trouve chez tous les apôtres de la seule chair, et qui donne à leur cynisme je ne sais quel accent amer d’inlassable revanche.”
“Ravier est condamné à ne rencontrer que le vide. “Rien n’est plus bas, ni plus vulgaire, que la façon dont je t’accepte, mais à peu près tout ce qui naît est d’origine impure”, proclame cet apôtre du plaisir, lorsque enfin l’objet de sa passion va lui céder. Il a d’ailleurs avoué, dès le début, parlant de ses maîtresses : “Mais tout cela ne va pas loin en moi”. Et à cette jeune femme qui se donne, ses paroles sont d’un Janséniste. (…)”
“Mais ce désespéré est cloué sur place. Sade, du moins, veut forcer la vérité : s’il n’atteint rien, du moins a-t-il tout essayé. Entre le contentement de Laclos, rieur, suffisant, complaisant, goguenard et la “frénésie éperdue” de Sade se place ce troisième personnage de Montherlant, (Ravier), immobile, qui va vers le plaisir en grimaçant, poussé par le hasard, tout en regardant du côté de l’ascèse, proclamant que seule la jouissance compte et assoiffé de pureté. N’est-ce pas pour la pureté qu’il admire Mlle Villancy, et ne dit-il pas expressément au début, qu’il ne veut pas la séduire ?”
“Voilà un paysage littéraire que nous ne connaissons pas encore, qui n’est ni celui, joyeusement libertin, des Liaisons dangereuses, - pour peu qu’on n’en scrute pas les fêlures, - ni celui, éperdu et furieux, du Marquis de Sade. Sur les terrains de la désolation érotique, ce classique est à naître : mais n’en voyons-nous pas l’ébauche dans ces trois actes de Celles qu’on prend dans ses bras, où tout semble jeté dans un abîme ? ”
“Précisément, le mot y est : “Je ne peux pas vous parler autrement qu’à cœur ouvert, en jetant tout dans l’abîme, comme si je parlais à une planète inconnue”. Et voit-on une conclusion plus désolée que celle-ci : “Les jeux sont faits… Malheureux sans toi ou malheureux avec toi…” ? (…)”
“Car, Il ne faut pas s’y tromper : sous leurs grands airs de politesse, tous les personnages de Celles qu’on prend dans ses bras s’entredévorent. Le pessimisme qui y règne est sans sortie de secours. Les êtres s’y pourchassent comme des insectes sur la mer. Ils ne se trouvent jamais ; pourtant ils se déchirent, et patiemment. Même lorsque Ravier n’en peut plus de chagrin, Mlle Andriot ne cesse de se préoccuper d’elle seule, - comme Ravier, comme Mlle Villancy. Mieux, elle ramasse une épingle pour la lui planter dans le cœur. Au cri de Ravier : “Mon malheur va de la terre au ciel", elle répond : “Comme l’homme sait mal souffrir ! (…). Si c’était moi (…). Mais moi, en sept ans (…)”, etc. Ces deux êtres se torturent : Ravier par estime de soi-même, Mlle Andriot par obstination dans l’aveuglement. Et lorsque la trahison de Mlle Andriot éclate, c’est presque un cri de libération que pousse Ravier : “Ne vous occupez pas de ce serpent, je lui écraserai la tête quand je le voudrai. Moi aussi, j’ai sept ans de haine (…)”.”
“Une pièce qui s’inscrit au coin de la férocité supérieure de l’esprit.”
Dans Les Nouvelles littéraires du 28 février 1957, Gabriel Marcel écrit :
“Rien sans doute d’aussi racinien n’a été écrit depuis Racine (…)”
1951, La Ville dont le prince est un enfant
Pièce en trois actes, créée au Théâtre Michel à Paris le 8 décembre 1967. La scène se passe entre les deux guerres, à Paris (Auteuil), dans un collège catholique, au printemps.
Peut-être le chef d’œuvre de Montherlant ? Certains le pensent.
 |
“Une des plus belles pièces de la littérature mondiale moderne.” (Harold Hubson in Sunday Times)
“C’est la pièce la plus importante du siècle.” (Jean Meyer)
La pièce est dédiée à l’Abbé C. Rivière, curé de campagne dans un village en Ariège. Cet homme prit les ordres à 40 ans. Un jour, tout inconnu de Montherlant, il vint sonner à sa porte. Et c’était pour dire à l’écrivain que son livre Aux Fontaines du désir était une des influences qui l’avaient mené à la vocation sacerdotale.
“Tout est grâce” m’expliquiez-vous (écrit Montherlant dans sa dédicace), les derniers mots du curé de campagne de Bernanos…
“(…) En écrivant La Ville dont le Prince est un enfant, j’ai servi assurément la vérité humaine. Si, de surcroît, j’ai servi la vérité catholique, je veux dire : si en refermant mon livre, le lecteur éprouve plutôt de la sympathie que de l’aversion pour cette cellule du monde catholique que j’y ai dépeinte avec honnêteté et respect, alors, monsieur l’abbé, votre nom sera doublement justifié au front de cette seconde “Relève du matin”, écrite par un homme “fidèle comme il n’est pas permis de l’être”.
Ma question : Montherlant “fidèle comme il n’est pas permis de l’être”, lui qui se définissait comme papillonnant, incapable de se fixer sur un être ? Fidèle à l’Eglise malgré son athéisme affiché ? Fidèle à la “gloire du collège catholique” ? Fidèle aux convenances avant de publier une pièce qu’il craint qu’elle soit mal comprise? Fidèle aux êtres aimés ? Il fut certainement fidèle en amitié à la condition de n’être pas trahi ni insulté. Et il fut fidèle aussi à ceux qu’il désigna comme ses héritiers.
Résumé
“Le préfet de la division des moyens, l’abbé de Pradts, se montre plein d’indulgence pour un élève de troisième, Serge Souplier (14 ans). Or, une amitié s’est nouée entre Souplier et un élève de philosophie, André Sevrais (16 ans), et l’abbé la voit d’un fort mauvais œil. Il travaille à séparer les deux garçons, et réussit à faire exclure du collège Sevrais. L’abbé triomphe, mais pour peu de temps. Le supérieur du collège, l’abbé Pradeau de la Halle, exclut aussi Souplier, et s’en explique avec l’abbé de Pradts en une scène, qui est à coup sûr, l’une des plus étonnantes du théâtre de Montherlant. C’est sur la troublante figure de l’abbé de Pradts qu’est nouée cette pièce dépouillée, tout en mouvements intérieurs et d’un inoubliable accent.” (Henri Perruchot, Montherlant, NRF, p.133).
Analyse
Dans cette pièce, Montherlant relate un évènement capital de sa vie, qui fut son renvoi en 1912 du Collège Sainte-Croix à Neuilly (voir dans Biographie la section Famille, enfance, adolescence).
Il vécut dans ce collège, à 16 ans, son premier amour avec un garçon de 14 ans, et cette passion fut si forte, et la douleur d’être expulsé de son cher collège et d’être séparé de son ami, si intense, que cet épisode de sa vie le brûla, l’incendia au point qu’il ne put jamais l’oublier. Toute sa vie, tous ses amours en gardèrent l’ineffaçable marque. Un peu avant son suicide, il écrivait encore à 76 ans dans Aimons-nous ceux que nous aimons, page 216 (livre posthume publié chez Gallimard en 1973), ce texte écrit le 12 décembre 1971 :
“Il y a des rêve prémonitoires. Il y a aussi des rêves révélateurs : qui nous révèlent quelque chose d’important sur vous-même ou sur le monde. Curieusement, je ne rêve jamais. Pourtant il a fallu qu’en cette fin d’année - les fins d’année toujours sinistres pour moi - me vint un rêve, sans doute très court, pas plus qu’une image, et au petit matin, à l’heure où les rêves empiètent sur la réalité. Dans ce rêve j’ai vu apparaître quelqu’un que j’ai aimé en des temps très lointains. A l’instant j’ai été éveillé par les battements de cœur précipités que me donnait l’apparition de ce visage béni. Je me suis tourné sur le côté gauche vers le mur, comme pour étouffer ces battements par le matelas, et il me sembla que je les envoyais à travers le matelas jusqu’au centre de la terre. S’ils m’avaient emporté, si ça avait été une crise au cœur, quelle fin de vie ! A la lettre, mourir d’amour. (…) Car le rêve du 12 décembre m’a montré que cet être était le seul que j’aie aimé de ma vie entière, que mes autres amours n’avaient été que des caricatures de celui-là, et que le bonheur même avait été peu de chose après lui. (…) Cette visitation silencieuse est bouleversante pour moi parce qu’elle bouleverse toute l’idée que j’avais de ma vie (…) mais non, on n’aime qu’une fois, et cette pensée s’ouvre pour moi sur la désolation.”
Cette pièce si pudique, si retenue, fut travaillée dès 1913 par Montherlant et portée par lui durant des années. Il montra la plus grande prudence avant de la publier, en 1951, et plus tard à la faire jouer. Il s’entoura d’avis d’autorités ecclésiastiques, dont celui de l’archevêque de Paris, Mgr Feltin, qui lui conseilla d’attendre pour la faire représenter. Il se passa donc 16 années entre la publication de ce livre chez Gallimard et la création au Théâtre Michel en 1967 à Paris. Je me rappelle avoir vu cette pièce à cette époque. Je fus frappé par l’intensité du jeu des acteurs, notamment Paul Guers qui jouait l’Abbé de Pradts, et celui des deux adolescents. Le visage des trois comédiens ruisselait de larmes. Et ces larmes n’étaient pas de théâtre.
Ceux qui caricaturent Montherlant aiment dire : il s’agit d’une histoire d’amitié particulière qui a mal tourné, d’où le renvoi du collège. Non, c’est plus compliqué. Ces deux amis sont dans un collège qui, apparemment est assez relâché dans les mœurs, car il y a des contacts entre élèves plus jeunes et plus âgés. C’est assez étonnant à cette époque sévère sur ces questions, mais c’est le récit de Montherlant, qu’il développera, plus tard et très largement, dans le roman Les Garçons publié en 1969.
Il est amusant de lire les souvenirs d’un autre élève de ce même collège, à la même époque, qui dira n’avoir jamais remarqué de “mauvaises mœurs” !
Les deux adolescents qui s’aiment sont victimes de la jalousie de l’abbé de Pradts qui veut que Sevrais cesse toute relation avec Souplier, son protégé, mais il ne le lui dit pas franchement.
“L’amour de Sevrais n’est pas de l’amour-passion ; Sevrais en a d’ailleurs conscience et l’affirme avec force. Il est une juxtaposition d’affection tendre et de sensualité, ce qui ne fait pas de l’amour-passion.” (Montherlant, Notes, Pléiade, Théâtre, p.828).
L’abbé de Pradts aime Souplier, l’attrait sensuel est évident, mais dit Montherlant :
“(…) l’attrait subi n’est pas un délit, pénalement, et chrétiennement, n’est pas un péché.” (Pléiade, p.827, Notes).
Mais l’abbé de Pradts n’a jamais cédé à des actes condamnables, et il n’y a aucune raison d’en douter. Le texte de Montherlant est très clair.
“Il n’y avait pas à le purifier (cet amour) (…) S’être si sévèrement et continuellement surveillé (…)”.
Le supérieur, exigeant qu’il ne revoie plus Souplier, dit d’ailleurs :
“Ce n’est pas une punition, c’est une précaution.”
Voyant que leur amitié indispose l’autorité du collège, Sevrais et Souplier décident de modifier leur relation, et de renoncer aux actes, afin que leur changement de vie soit aussi un exemple pour les autres camarades. Les deux garçons sont surpris dans la resserre (acte II) par l’abbé de Pradts, au moment où ils discutent de leur nouvelle vie ; l’abbé de Pradts en profite pour faire renvoyer Sevrais, persuadé que cette amitié sensuelle n’a pas cessé.
Il y a donc une erreur d’interprétation commise par beaucoup. Cette pièce montre que Sevrais et Souplier sont prêts à faire le sacrifice des actes, pour vivre une amitié pure et renouvelée. Mais l’autorité qui voit le mal partout, conclut immédiatement que, s’ils s’enferment dans la resserre, ce n’est pas “pour attraper des mouches”.
 |
|
|
Montherlant vu par Mac' Avoy (1949). |
Cette pièce est donc la description d’une amitié tendre et sensuelle sacrifiée à un idéal, et elle ne sera pas comprise par les adultes. Cette amitié est montrée du doigt, défigurée, et le réformateur Sevrais sera chassé du collège ! La Réforme, voilà le maître mot de cette pièce ! Et ce mot, austère, nous ramène à ce goût de Montherlant pour le dépouillement, le renoncement, qui s’exprime chez Alvaro dans Le Maître de Santiago, le roi Ferrante dans La Reine morte, les religieuses jansénistes de Port-Royal, Jeanne la Folle dans Le Cardinal d’Espagne. Pour Montherlant, la Réforme isole et ne peut être comprise du grand nombre. On revient à son obsession d’un Ordre, accessible à un petit nombre d’élus.
Dans l’hypothèse où Montherlant a vécu cet épisode dans sa vie, le renvoi par l’autorité, le fait d’être déconsidéré et humilié parmi les élèves, lui le plus brillant, lui le plus admiré, alors que ses intentions étaient pures, a dû le marquer à tout jamais. Cette exclusion sociale fera de lui, certainement, un homme méfiant pour qui l’amour est quelque chose de dangereux et de risqué, même si toute sa vie “il n’a pu qu’aimer”. Les prêtres saccagèrent un cœur, un amour, d’un jeune encore désarmé. On comprend la colère de Madame de Bricoule, la mère d’Alban dans Les Garçons, quand elle apprend que le collège se sépare de son fils.
– “Tu es renvoyé ?
– Oui. (…)
– Quels saligauds ! dit Mme de Bricoule. Tu n’as jamais rien compris à cette histoire. De Pradts était jaloux de toi et t’a laissé t’enferrer pour avoir un fait qui lui permettait le renvoi. Si au moins il avait agi avec des armes loyales…
– Oh ! vous savez, quand on est dans une passion !
– Prends garde ! Tu obéis à un mouvement de vanité en te donnant les gants de ne pas lui en vouloir.
Alban hausssa les épaules. Elle continua :
– Les prêtres, les religieux, c’est une vaste blague. Ils sont exactement pareils aux autres. Ni pires ni meilleurs : pareils. C’est comme cela qu’ils sont menteurs, fourbes, légers, snobs, mufles (pourquoi, par exemple, ne peut-on dire de tel religieux qu’il est un mufle ? Et pourtant, Dieu sait si j’en ai connu qui…) (…) Ce qui est grave, c’est que par leur soutane ou leur robe, ils font croire qu’ils sont meilleurs, alors qu’ils ne le sont pas : ils vivent dans un perpétuel abus de confiance, ils vivent dans la fausseté… Et ils “connaissent les âmes” ? Qu’est-ce qu’ils en peuvent connaître puisqu’ils ne connaissent rien de la vie ? Peut-être qu’ils connaissent les mioches, mais juger des foyers, des mariages, des adultères, il y a de quoi rire ! Ce sont de pauvres types, et il y a des familles qui remettent tout de leur destinée, et de la destinée de leurs enfants, à ces zozos ! C’est monstrueux.
Alban écoutait scandalisé.”
(Pléiade, Les Garçons, Romans II, p.701-702)
Montherlant adulte a-t-il cherché à revivre cette sorte d’amour à risques, menacé par l’autorité ? Fut-il “brûlé”, “marqué au fer rouge” à 16 ans par cet amour et fut-il obligé, plus tard, de revivre sans cesse des amours condamnées ? Une erreur magistrale serait de ranger Montherlant dans une catégorie ou de le caricaturer. Dans plusieurs de ses livres, il donne les récits ou raconte les souvenirs d’amours hétérosexuels vécus par lui. Pourquoi ses ennemis, dès lors, font-ils comme si ces textes n’avaient pas de valeur ou étaient mensongers ? Pourquoi font-ils l’impasse sur les descriptions (où il utilise le “Je”) de ses amours féminines ? Pourquoi ne lisent-ils pas Mais aimons-nous ceux que nous aimons, avec le portrait de Douce, notamment ?
On ne trouvera, dans son immense œuvre littéraire, aucune description d’un Montherlant s’avouant homosexuel, ou pédéraste. Alors, homosexuel honteux ? Ou pédéraste caché comme l’ont matraqué Sipriot le “biographe-qui-démasque” et “Peyrefitte-la-Peste” ?
“Bel esprit venimeux, rien d’autre”, disait Montherlant, de Peyrefitte (ce que rapporte Henry Muller dans ses Retours de mémoire, Grasset, 1979, p.118). Peyrefitte avait la spécialité, obsessionnelle, d’indiquer partout, avec délectation et sans preuve, des homosexuels honteux et, notamment, trois Papes du XXe siècle, qu’il offensa sans risque car la Papauté n’a pas pour habitude de poursuivre en justice les écrivains à scandale. N’empêche, il y eut scandale ! Comme pour Montherlant !
En 1970, dans son livre Des Français, Peyrefitte, traité “d’assassin de lettres” par François Mauriac, n’hésita pas à outrager Montherlant, vieillard et malade, à la santé chancelante, presqu’aveugle, n’ayant pas la force de se défendre, de faire interdire le livre, de riposter en justice. Son suicide est proche, qu’il exécutera en 1972.
Ce n’était pas suffisant ! Peyrefitte, amateur de tirages que les ragots soutenaient, remit une nouvelle couche plus ignoble encore en 1977 avec les nouvelles pages, ahurissantes et encore plus “infâmantes” de ses “Propos secrets” (dixit Henry Muller, Retours de mémoire, p.118), à la façon d’un psychopathe poursuivant un Montherlant mort pour essayer de l’abattre définitivement. La curée ! Les offenses au cadavre !
“Aussitôt que je serai mort, deux vautours, la Calomnie et la Haine, couvriront mon cadavre pour qu’il leur appartienne bien à eux seuls, et le déchiquètteront.” (Carnets 1972).
Montherlant avait tout prévu, et il ne se faisait pas d’illusion sur ceux qui l’attaqueraient après sa mort. Comme il a vu clair ! Comme il ne s’est pas trompé ! Il avait prédit dès 1931 :
“Mes œuvres, toujours outragées, c’est moi, comme un prince en habits de parade, que la populace traîne par des crocs, respirant encore, jusqu’aux égouts.” (Carnets, 1930 à 1944, Pléiade, Essais, p. 989).
Les deux tomes de la Biographie de Sipriot (1982 et 1990) ne condamnèrent pas les écrits de Peyrefitte de 1970 et 1977. Sipriot dédiera le second tome de sa grosse biographie à celui qui avait outragé Montherlant !
Qui porta plainte contre ces outrages ? Personne !
Pourquoi Sipriot ne prit-il pas la peine d’interroger une amie de Montherlant, toujours en vie, Madame Elisabeth Zehrfuss ? Elle aurait pu donner, peut-être, un autre éclairage sur l’écrivain …
Les souvenirs, notes, ou Journal de Marguerite Lauze, amie de Montherlant et héritière unique avec son fils, décédée quatre mois après Montherlant qu’elle connut durant des dizaines d’années, existent-ils ? Elle écrivait remarquablement : il suffit de lire dans la Pléiade Montherlant, Théâtre, p.765, sa longue étude très fouillée sur La Ville dont le prince est un enfant. Dans ce cas, pourquoi ne publie-t-on pas les souvenirs de Marguerite Lauze ?
Et la correspondance entre Montherlant et une de ses amies, une fiancée (?), gardée cachetée chez un notaire, pourquoi ne fut-elle pas ouverte comme Montherlant le voulait ? A plusieurs reprises, Montherlant a parlé de cette correspondance. Pourquoi ces réticences ?
En outre, il est dommage que Jean-Claude Barat, l’unique héritier avec sa mère de Montherlant, ne publie pas son Journal encore inédit, vu qu’il a vécu, dès son jeune âge, très proche de Montherlant qui fut l’ami de sa mère, Marguerite Lauze. Ces familiers de Montherlant ont certainement leurs raisons de garder le silence. Mais une mise au point 35 années après la mort de l’écrivain ne serait-elle pas bienvenue ?
Peut-on affirmer une certitude quand il s’agit d’écrire sur la sexualité d’ une personne ? Qui se porte témoin ? Qui raconte ? La méchanceté ignoble de Peyrefitte le discrédite.
Je pense, personnellement, sur base du courrier qu’il m’a adressé, que Montherlant était peut-être un “totaliste”, et que n’étaient pas exclues des amours variées, pour autant qu’elles ne causent pas de mal : des “jeunes filles”, comme Christine Vallency dans Celles qu’on prend dans ses bras, ou Ram de La Rose de sable, ou Solange Dandillot des Jeunes filles, ou des “jeunes femmes” comme Isotta de Malatesta, ou Inès de Castro de La Reine morte, ou des “jeunes garçons” comme Souplier dans La Ville et les Garçons. Tout est probable et rien n’est certain avec ce génie, qui aurait pu porter le nom de “Légion” en référence au Nouveau Testament !
Un homosexuel ou un pédéraste peut-il écrire un millier de pages sur Les Jeunes Filles, roman tiré à des millions d’exemplaires et lu avec avidité par les femmes ? Fameuse prouesse dans ce cas ! Le biographe Sipriot fut plus préoccupé, dans les deux tomes de son Montherlant sans Masque, par les mœurs pédérastiques qu’il attribue à Montherlant avec générosité, alors que l’écrivain lui-même n’a jamais rien révélé sur ce sujet dans toute son œuvre ! Et le plus étrange est que Sipriot est obligé de constater que “nulle part, on n’a jamais pu trouver la moindre trace d’un dossier mœurs contre Montherlant” ! (Sipriot, tome 2, p.143). Montherlant fut décoré de la Légion d’honneur avec le grade d’Officier. L’aurait-il été avec un dossier mœurs aux Renseignement généraux ?
Il ne faut jamais oublier qu’à plusieurs reprises, à la fin de sa vie, Montherlant a dit à des proches: “Je n’ai jamais rien fait de mal”, et aussi qu’il a écrit dans La Marée du soir : “Si le Dieu des chrétiens est le bon, je suis bien tranquille”. Alors ?
Ecoutons ce que nous confie le grand comédien Pierre Descaves, Administrateur à la Comédie-Française:
“C’est à la Comédie-Française, entre 1953 et 1959, que j’ai appris à mieux connaître l’homme.
Au répertoire du Français, j’avais trouvé deux œuvres maîtresses : “La Reine morte” et “Pasiphaé”. Ce n’est pas sans longs travaux d’approche que j’obtins de lui son “Port-Royal”. Par la suite, je fis monter “Brocéliande” et reprendre “Le Maître de Santiago” (…) Aussi aurai-je pas mal pratiqué cet auteur “combattant”, c’est à dire soucieux de préserver, sur tous les terrains et dans tous les cantons, son œuvre - laquelle est son incessant et intime combat. Des précautions ? Un visage composé ? De feintes attitudes ? Je n’ai jamais rien vu de tout ce que la clabauderie clandestine ou la chronique malveillante prêtent à ce grand honnête homme.
(…) Méticuleux, méthodique, les poches, le gousset gonflés d’indications transcrites sur les papiers les plus hétéroclites. Montherlant ne laisse jamais rien au hasard, avant, pendant et après la présentation d’une de ses œuvres. Au cours des répétitions proprement dites, il est le premier arrivé, le dernier parti : ferme, mais courtois, la nuque tassée et gonflée sous l’effort de la patience et de l’attention, il semble “réceptionner” le texte qu’il a nourri d’une sève riche et dont il connait toutes les essences. Il souffre vraiment lorsque des répliques sont rendues boiteuses par le manque de préparation d’un comédien. Il se tait. Il a merveilleusement décrit ce mystère des répétitions : “On embarque sur la scène par une passerelle, comme sur un navire. Les passagers regardent la mer ténébreuse – la salle – en portant leurs avant- bras au dessus de leurs yeux pour se cacher le miroitement aveuglant du large.” Aux arrêts, aux entractes, aux pauses, se succèdent ses critiques, ses remarques, ses indications : la voix se fait plus sourde, basse, toujours nette ; le débit, à la fois vif, rapide et retenu.
Quelles étonnantes leçons prodiguées sans faiblir ! Je l’écoutais toujours avec émerveillement en songeant à ce qu’il devait encore retrancher de sa plainte : “Une vie pour produire; une vie pour regarder produire; et une autre pour juger sa production”. De ces trois vies, je voyais les deux dernières, où se situait son tourment de créateur, où perçait le drame intime de l’artiste sur la valeur humaine de la création, sur une possibilité sinon de rachat, du moins du sauvetage de quelques hommes.”
(Revue La Table Ronde, novembre 1960).
Ainsi, vaut-il mieux décortiquer l’œuvre que se repaître de médisances ou de calomnies. L’homme est l’ombre de son œuvre. C’est l’œuvre qui est éblouissante. Tout n’a pas encore été dit sur Montherlant. Qui furent les auteurs du scandale? Montherlant muet, ou ceux qui voulurent fouiller sans pudeur sa vie privée, fascinés par les matériaux et les interprétations ignobles de Peyrefitte ? Comme l’écrit Philippe de Saint Robert :
“Il y eut de tout temps, dans les lettres françaises, des miliciens chargés de l’ordre, des dénonciateurs publics, des gens qui ne pensent signaler leur vertu qu’en blâmant celle des autres. Montherlant aura été par deux fois, la première au lendemain de la dernière guerre et la seconde dix ans après sa mort (…) victime du ressentiment de ceux qui, ne lui pardonnant pas de nous faire respirer à une certaine hauteur, se sont érigés en Sainte-Beuve d’occasion pour opposer sa vie à son œuvre…” (Montherlant ou la Relève du soir, par Philippe de Saint Robert, Les belles lettres, p. 231).
On n’inquiéta jamais le célèbre peintre anglais, Francis Bacon, du fait de ses mœurs ! Au contraire, on en sourit ! Et sa peinture est celle du génie. Même chose pour Rimbaud et Verlaine ! Que nous importent leurs amours, quand leurs poèmes sont immortels ! Mais à Montherlant, il faut un procès, où tout sera instruit à charge, et l’accusé ne sera jamais entendu !
Je transcris ici un extrait de l’ouvrage de Madame Marya Kasterska, femme de lettres polonaise, Sienkiewicz et Montherlant, dans lequel elle établit un parallèle entre Montherlant et le Pétrone, sceptique et voluptueux, courageux aussi de Quo Vadis ?
“Montherlant est un homme sans dogme, une âme impressionnable, subtile, infiniment sensible à la beauté sous toutes ses formes, très consciente de son originalité, de sa supériorité et, à cause de cela, se créant sa propre morale et son propre code des lois de la vie, d’où un désaccord entre l’âme et le monde qui l’entoure.” (Cité par Faure-Biguet, Les enfances de Montherlant, 1948, chez Henri Lefebvre, p.21).
Et ce passage d’une lettre que Montherlant m’adressa le 18 février 1970 :
“J’ai eu, je crois, dans la sérénité, toutes les formes du désespoir, comme j’ai toutes les formes de tout.”
De 1947 à 1953, conflit entre Montherlant et son éditeur Grasset
L’éditeur Grasset aura de gros ennuis après la guerre pour avoir publié certains auteurs coupables de collaboration avec l’Occupant. A la Libération, Grasset sera anéanti.
Je reprends ici, et résume, quelques extraits du chapitre XX, p. 327 et suivant, du tome 2 de la biographie de Sipriot sur Montherlant :
“Pendant dix ans, de 1944 à 1954, l’œuvre de Montherlant, dont l’éditeur est Grasset, est en cours de procès. Pendant tout ce temps, Montherlant sera privé d’éditeur. L’œuvre complète de Montherlant ne réapparaîtra, en édition courante, qu’à l’automne 1954, chez Gallimard. Bernard Grasset fut condamné, par la Chambre civique le 20 mai 1948 à la dégradation nationale à vie et à la confiscation de ses biens. Grasset a refusé de comparaître. Le 17 juin 1948, c’est la Maison Grasset qui est jugée par la Cour de Justice de la Seine. Grasset est présent et se défend avec énergie. Cette défense est sans effet. La Cour reproche à Grasset d’avoir publié Georges Suarez qui a été fusillé en 1945, Drieu La Rochelle qui s’est suicidé, Jacques Chardonne qui a été emprisonné, Abel Bonnard passé en Espagne, et Le Solstice de juin de Montherlant.
Montherlant et son Solstice de juin ont été longuement cités par le substitut de la République, un certain Lacazette : Il faut lire son réquisitoire : “Je parlerai d’abord du Solstice de juin de Montherlant, où l’auteur développe l’idée que l’alternance est la règle à laquelle tout est soumis. Les peuples sont pris dans ce mouvement : victoire, défaite, république, dictature, la France a poussé jusqu’à sa fleur, si l’on peut appeler cela une fleur, quelque chose. Il s’agit maintenant pour elle de faire fleurir autre chose, qui est également elle-même, mais en elle-même tout différent et en apparence opposé (…) Elle a réalisé que le droit du vainqueur sur le vaincu n’est limité que par l’intérêt du vainqueur. Oui, Montherlant a écrit un livre déplorable (…) Vous devez me comprendre : un auteur n’est jamais coupable que d’un exemplaire. Un éditeur est coupable de milliers d’exemplaires. Donc l’éditeur doit être poursuivi par la loi avec plus de rigueur que l’auteur (…) Ce n’est pas l’auteur qui a fait le délit du crime, c’est l’éditeur. Le livre est conçu. Il n’est pas dangereux tant qu’il n’est pas publié. C’est l’éditeur qui l’imprime. C’est l’éditeur qui l’impose par sa publicité (…) L’auteur est un soldat de l’armée du génie des lettres, l’éditeur, lui, est le général.”
Le jugement qui condamne Grasset rend en 1948, la liberté de publier ailleurs à des écrivains comme Mauriac, Montherlant, Maurois, Malraux. Rappelons que Montherlant ne fut pas condamné (voir dans Biographie la section Guerre de 40-45 consacrée au Solstice de juin).
En 1949, par décision du Président de la République Vincent Auriol, Grasset peut reprendre sa maison.
En février 1949, Montherlant qui veut se séparer de Grasset depuis 1940 rédige un “mémoire sur ses Relations personnelles avec Bernard Grasset. Un procès se poursuivra entre Grasset et Montherlant, où il apparaît que le sort de Montherlant chez Grasset “est le plus défavorisé subissant la baisse (des ventes) la plus forte et la plus prolongée. Montherlant reproche à Grasset de l’avoir volontairement boycotté.
Justice sera rendue en 1953 à Montherlant. En 1954, après près de douze ans d’absence en édition courante, l’œuvre de Montherlant est enfin rééditée en totalité chez Gallimard.”
(Extrait du chapitre XX, p. 327 à 334 du tome 2 de la biographie de Sipriot).