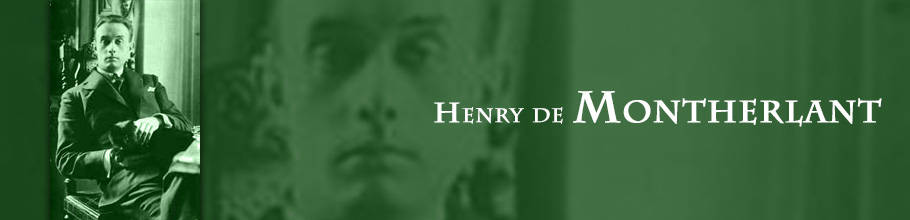
Biographie
3. Le Voyageur
En 1919, création de l’Ordre
Montherlant sent le besoin de fonder avec quatre amis une société “un peu codifiée et un peu âpre”. (…) Les deux aînés, dont lui, avaient combattu (blessés et cités), les autres avaient vingt et un, seize et quatorze ans… Ce sera “l’Ordre” !
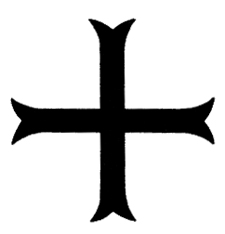 |
Montherlant trouvait le monde d’après-guerre abject. Pour échapper à cette abjection, deux voies s’offrent à lui : celle de la conduite solitaire et celle du petit clan. Il était impensable pour Montherlant de sacrifier l’individu.
“Je pense que l’individualisme est le produit des civilisations supérieures”.
Mais aucun des jeunes gens ne veut être solitaire. Le petit clan se forma donc. Montherlant regrette l’esprit de la guerre. “J’apportais une insatisfaction guerrière, du mépris pour les civils, de la sollicitude tendre pour les sentiments héroïques”. Montherlant reconnaît que tout cela restait très juvénile et dans la même ligne que “la Famille” fondée par lui au Collège Sainte-Croix à Neuilly en 1912. L’Ordre répond à un “besoin de séparation d’avec le milieu, pour pouvoir vivre une vie respirable, c’est un repliement sur une poignée d’êtres choisis”.
Les cinq amis pensaient être les meilleurs, aimaient donner des leçons à tout le monde (le pli m’en est resté, avoue Montherlant). Ils se considéraient comme des chevaliers (comme des samouraïs ou des templiers, des opposants aux bourgeois).
“Il ne saurait en être autrement pour quelqu’un qui porte une civilisation intérieure plus rare et plus avancée que celle qui a cours autour de lui. L’orgueil est un devoir.”
On croirait entendre le Japonais Mishima ! L’Ordre se caractérisera aussi par la solidarité, même jusqu’à l’assistance financière, ce qui résista le plus longtemps et fut le mieux observé. La morale de l’Ordre était :
“Droiture, fierté, courage, sagesse, puis fidélité, respect de sa parole, maîtrise de soi, désintéressement, sobriété”. “C’était de la morale naturelle, écrit Montherlant, mais nous poussions chacun de ces sentiments au chevaleresque (…) Notre morale de clan était un peu hors la loi, un peu dangereuse. C’est ainsi que nous eussions fait sans le moindre remords, un faux témoignage devant les tribunaux, pour sauver un des nôtres.”
Leurs couleurs étaient le noir et le blanc, comme celles des Templiers et des chevaliers teutoniques ! Le Christianisme était absent dans cet Ordre.
“Là encore l’Ordre continuait la “Famille” de Sainte-Croix, où nous réalisâmes ce paradoxe que, gouvernés et excités par des prêtres, toute notre chevalerie ne fit jamais la moindre part au surnaturel, et que Jésus-Christ n’y compta nullement”.
 |
|
Les femmes ne devaient pas compter non plus dans cet “Ordre”. Ni rapport avec le sexe, ni même galanterie ! Montherlant cite Raoul de Cambrai :
“Maudit soit le chevalier qui va demander conseil à une dame”.
Montherlant va alors s’amuser. Il écrit :
“Ô lectrices des petits journaux de modes, flétrissez comme il se doit ces soi-disant preux, qui n’étaient en somme que des “mufles” ! Loin que les femmes aient joué le noble rôle que l’on croit dans la chevalerie, elles ont été un des ferments de sa décomposition, lorsqu’au milieu du XIIIe siècle, leur goût, devenant maître, a imposé le passage de la saine et sublime littérature germanique des chansons de geste aux niaiseries fades et fausses des romans bretons de la Table ronde. Les romans de la Table ronde, sous le couvert de la galanterie, c’est la chiennerie qui commence ; et c’est - plus grave encore - la morale de midinette, qui, depuis lors jusqu’à nos jours, en l’émasculant et en l’éloignant du réel, a fait tant de mal à notre France.”
Ils conclurent un pacte qui aurait une durée de quatre années.
“Il était non seulement de ne faire jamais quoi que ce fût l’un contre l’autre, mais de tenter d’empêcher, par toutes ses forces, le mal qu’un tiers pouvait vouloir à un de nous ; et de s’aider, en n’importe quelle rencontre.”
L’Ordre vécut dix mois. C’est Montherlant qui par sa présence y mettait quelque chose de trop tendu :
“(…) une atmosphère irrespirable, comme si dans tout cela je n’avais cherché, sans le vouloir, qu’à aviver une conscience toujours plus pathétique de moi-même (…) L’Ordre des derniers temps n’était plus qu’une boîte fermée, une machine à se faire souffrir les uns les autres.”
Montherlant se tourna alors vers le sport athlétique. Mais pour lui, Ordre et sport restèrent des choses distinctes. C’est en juillet 1940, en pleine débâcle, que Montherlant détailla dans Le Solstice de Juin ses souvenirs sur l’Ordre de 1919 (Essais, Pléiade, p. 858 à 872) dont les extraits ci-dessus cités sont tirés.
En octobre 1920, La Relève du Matin
Montherlant publie à compte d’auteur La Relève du Matin, commencée en 1916 et qui sera refusée d’abord par tous les éditeurs de Paris. Il s’agit d’un livre de ton lyrique, une suite d’essais, une sorte de grand poème à la gloire d’un collège catholique. Un chapitre s’intitule d’ailleurs La Gloire du collège. Pour Montherlant, l’éducation religieuse que reçoivent les enfants a le mérite de leur donner le sens de la vie intérieure.
“Ce collège, cette musique, ces offices, cette action des prêtres, c’est cela leur rôle : maintenir vivante en nous la partie de nous-mêmes de laquelle nous avons tiré l’idée du divin (…) Ô prêtres, dans certaines âmes, pour l’amour de Dieu et pour l’amour d’elles, systématiquement, créez de la crise !”
Ce livre établira très vite sa réputation littéraire, - Mauriac (“tout enduit d’eau bénite”), lui écrit - et certains des thèmes de La Relève seront repris plus tard dans La Ville dont le prince est un enfant et dans Les Garçons.
Dans une préface plus tardive, datée de mars 1933 à Alger, Montherlant reconnut quelques défauts à ce livre, dus à la jeunesse.
“Fleuri, tarabiscoté, impropre et prolixe, le style de ces pages est le plus souvent indéfendable. (…) (mais) cette réalité (du sujet) en nous est restée intacte (…) La maladie de la jeunesse est partout dans La Relève : l’auteur la décrit chez les autres, mais elle est en lui et il l’ignore.” (Essais, Pléiade, p. 14).
Il est intéressant de lire dans cette préface de 1933 ce qu’écrit Montherlant sur sa foi en Dieu :
“Nous n’avons jamais été un chrétien authentique. Mais nous avons toujours été quelqu’un pour qui le bien et le mal existent, et qui a adoré la morale naturelle à travers les formes de la machine catholique”.
La pente de Montherlant est donc la morale naturelle. Pas besoin pour lui d’une providence ni d’une survie, ni d’une justice d’outre-tombe ; la divinité est une question secondaire pour lui. Dans cette préface de 1933, Montherlant très lucide sur les défauts de son livre, annonce déjà le futur massacre de 1940.
“La France des temps modernes a choisi le mode de vie qu’elle préfère. Ce qu’elle veut, c’est porter toutes les n années au Minotaure quinze cent mille de ses jeunes gens, pourvu que, grâce à ce tribut, le reste du temps elle puisse ne pas s’en faire. C’est cela que la France a choisi. (…) D’ailleurs, les quinze cent mille jeunes gens trouvent la combine excellente. Ils acceptent d’être dévorés demain ou après-demain, pourvu que jusque là, ils puissent n’avoir aucune préoccupation dans leur vie - mais ce qui s’appelle aucune - que de savoir par combien de buts l’équipe du X… a battu l’équipe du Y…
Le 17 octobre1920, Paul Claudel écrit une longue lettre à Montherlant :
“Depuis longtemps il ne m’était arrivé de lire un livre avec autant d’intérêt et de joie que La Relève du matin (…) Il y a dans votre livre des passages admirables sur le rôle de beauté de l’Eglise, sur la parenté naturelle de ses rites avec les gestes les plus sublimes de l’art grec (…) Vous parlez admirablement du reflet de la guerre sur les visages humains (…) L’importance suprême que vous donnez à l’enfance (…) Je n’aurais jamais cru qu’un collège pût laisser de tels souvenirs. Quant à moi, de mes huit années de lycée, je n’ai gardé qu’une impression d’horreur et de révolte.” (Extrait de Sipriot, tome I, page 221).
 |
Le 7 juillet 1921 : Montherlant reçoit le prix Montyon de l’Académie française. Le livre (à compte d’auteur) est épuisé. C’est l’éditeur Bloud et Gay qui le reprend.
On aurait vu, alors, selon son perfide biographe Sipriot, un curieux phénomène. Montherlant se serait retourné contre son œuvre, en discréditant La Relève avec un article rédigé sous un nom d’emprunt. Sipriot raconte ça, mais n’en donne pas la preuve, ne cite pas le nom d’emprunt, ni le journal ou la revue où ce contre-article aurait été publié !
Dans cet article de dénigrement, Montherlant (sous un autre nom) se serait donc comparé à Chateaubriand à qui il ressemble “par l’œuvre de décomposition que lui aussi a accomplie, en la parant des prestiges de la religion et de la vertu (…) Chateaubriand et Montherlant (dixit Montherlant caché sous le nom d’emprunt), ont selon le mot fameux de Sainte-Beuve, fait avaler le poison dans l’hostie”…
Que Montherlant ait lancé des articles sur son œuvre, pour orchestrer, faire du tapage, faire parler de lui, même en mal, c’est possible. Mais dans ce cas, il faut citer la source. Qui dit que Montherlant ne s’est pas amusé à écrire contre son œuvre, pour le plaisir, pour l’alternance si exquise, et il est très probable que cet article, comme un jeu de l’esprit, n’est jamais sorti des tiroirs de l’écrivain.
En 1922, Le Songe
Publication du roman Le Songe qui relate l’arrivée au Front d’Alban de Bricoule.
“Dans Le Songe, a écrit Montherlant, j’ai raconté l’histoire d’un volontaire de guerre, qui y va quand il veut, en revient quand il veut, fait la guerre comme on fait l’amour”.
Alban de Bricoule a une amitié pour son camarade Prinet, un aspirant, d’un milieu plus modeste, et qui a des défauts évidents. Malgré cela, Alban continue à l’apprécier,et lorsque Prinet est tué, Alban se fait rapatrier à l’arrière.
Alban a une amitié amoureuse avec une jeune fille Dominique Soubrier, devenue infirmière pour se rapprocher de lui. Mais Alban ressent l’amour de celle-ci comme une menace contre un ordre (lequel ? le sien ? sa liberté ? l’ordre de la guerre ?) auquel il veut rester fidèle. Il commence à mépriser la jeune fille. Mais ce mépris s’accompagne d’un désir physique. Quand Dominique Soubrier se livre à lui, il la refuse, sacrifie la jeune fille, et la sentimentalité qu’elle incarne, et remonte vers le Front.
Il est amusant de constater la ressemblance du nom de Soubrier, la jeune fille du Songe, avec Souplier l’ami chéri des Garçons ! La Soubrier est rejettée, et le Souplier est le seul être que Montherlant ait vraiment (le plus) aimé de toute sa vie !
Montherlant : un sportif “olympique”
 |
S’il montait à cheval avec son père, et s’il toréait de jeunes taureaux en Espagne, il cherche à s’ouvrir aussi vers le monde extérieur, et décide de s’inscrire à un club sportif où il va tâter, à son rythme, durant un an, de toutes les “spécialités” sportives sous la direction de Georges Carpentier, son moniteur.
Montherlant, un sportif avec une hypertrophie cardiaque ? Et après avoir été blessé de sept éclats d’obus en juin 1918 ? Oui ! Il a pris sciemment des risques pour retrouver une camaraderie, un esprit comme celui connu au collège, une jeunesse avec qui se sentir de plain-pied.
Son médecin, le docteur de Martel, l’autorise à jouer au football, et à courir le cent mètres, course où Montherlant pouvait bloquer sa respiration.
“Le cent mètres est une course pour idiots, c’est pourquoi j’y réussissais. Au “préparez-vous”, on se gonfle d’air la cage thoracique, et on la bloque ; au “Partez” on pousse comme un sourd ; c’est tout (…) Je courus le 100 mètres en onze secondes 4/5, temps honorable, réalisé sur la piste de l’hippodrome de La Courneuve, mais mon temps ne fut pas homologué par un chronométreur officiel (Mais aimons-nous ce que nous aimons ?, Gallimard p.113).
Le record fut signalé dans L’Auto, ce qui remplit Montherlant de fierté !
1923 : Mort de sa grand-mère maternelle la Comtesse de Riancey, née Marguerite Potier de Courcy.
1924 : Publication des Olympiques.
- Première Olympique ou Le Paradis à l’ombre des épées
- Deuxième Olympique ou Les Onze devant la porte dorée
Montherlant est fasciné par la boxe. Un de ses plus beaux poèmes publiés dans Les Olympiques est consacré à la boxe. Voici quelques extraits du poème “Critérium des novices amateurs” :
“(…) Eh là ! le voila dans les cordes, et le sang sur le corps frais lavé,
et les cordes longtemps frissonnantes alors que lui déjà s’est relevé,
Le moindre petit calicot prendrait place au milieu des Vivants
par la seule, sainte et splendide soudaine apparition de son sang.
D’une seconde à l’autre, très distincte, j’ai l’impression d’une bataille perdue.
Qu’a-t-il ? Au lieu de répondre, il remonte sa culotte avec ses mains pattues.
Il rarrange stupidement ses cheveux (le geste type du “novice amateur”).
Il jette un coup d’œil plein d’angoisse dans la direction du gong libérateur.
Et sa garde ? Il se couvre ! Et ses grands bras stupides qui fauchent !
Bien ! Au bout de trois rounds, il s’aperçoit enfin qu’il a un gauche !
Encore, ton gauche ! Encore ton gauche ! Ah ! malheur ! l’in-fighting le secoue !
Et pourtant tout cela sans que le rouge une fois monte à ses joues.
Il sourit. Comme, dans les tirs forains, le zouave sonne un petit air si on le touche
à chaque fois qu’il est bien touché un pauvre sourire crispe sa bouche
Il vague avec des bras tendus, tel un homme à demi endormi,
il s’appuie contre celui qui le frappe comme sur l’épaule de son meilleur ami.
D’un regard douloureux vers l’arbitre, il implore qu’on fasse cesser ça,
mais moi, si j’étais l’arbitre, je sais bien que je n’arrêterais pas le combat (…)”
(Les Olympiques, Roman I, Pléiade, p.329)
 |
|
Il s’agit d’un ensemble de textes en prose, de poèmes et de dialogues mettant en scène des jeunes hommes ou des jeunes filles pratiquant les sports les plus variés : football, athlétisme, cross-country, boxe, course de relais, etc. Mais, c’est l’athlétisme qui passionne Montherlant, tant comme athlète que comme entraîneur. Il recherche dans le sport, la communauté, la camaraderie, “la plaine couverte d’un vaste tutoiement”.
Certains poèmes ont des cadences à la Claudel. Les textes sont des descriptions de jeunes gens confrontés à leurs limites physiques, cherchant à se dépasser, à souffrir, à battre des records. L’écrivain est attentif à ceux qui échouent. Il est plein d’affection pour les athlètes féminines qu’il décrit avec minutie et émotion.
Il va résumer les sentiments qui le guident dans ce livre : sympathie, camaraderie, gentillesse. Pour Montherlant, dans le sport, l’essentiel n’est pas battre des records, mais :
“(…) ce sont les heures de poésie que le sport nous fit vivre, dans la grâce - la beauté parfois - des visages et des corps de jeunesse, dans la nature et dans la sympathie (…) La poésie, là est peut-être le résidu du sport.” (Préface de 1938 aux Olympiques).
Ernst-Robert Curtius écrira “qu’avec les Olympiques, Montherlant avait ouvert grandes les fenêtres de la chambre où venait de mourir Proust” (que Montherlant admirait).
“L’année 1924, où je publiai Les Olympiques m’apporta la notoriété, et m’en retira le goût. J’eus l’idée de ce que c’était : cela me suffit. Ce fut la seule année où je sentis autour de mes ouvrages une sympathie sans mélange, sentiment que peut-être je ne suis pas fait pour soutenir. Je vis le chemin de velours, et bronchai.” (Avant-propos de Service inutile écrit en 1935).
Il liquide la maison familiale
Le 15 janvier 1925, Montherlant liquide la maison familiale de Neuilly.
Sa chère grand-mère est morte en 1923. Le frère de sa mère, l’oncle Henry de Ryancey, va mourir seul, en mars 1925, comme Léon de Coantré, le personnage des Célibataires. Cette mort émeut très fort Montherlant qui est à Madrid, et qui apprend le décès un mois après l’évènement.
“Il n’y a personne avec qui j’aie eu plus d’intimité, je ne dis pas de pensée, mais d’habitude.” (Lettre à sa tante de Courcy, 1925).
L’oncle Henry l’avait aidé à ranger les innombrables objets et mobiliers de la succession familiale (trente malles et caisses faites par lui). Montherlant va déposer du mobilier dans un garde-meubles, et “muni de deux valises, il va partir pour dix ans de voyages, en Méditerranée, en Italie, en Espagne et surtout en Afrique du Nord”. Il va jeter sa gourme à trente ans.
Séjour en Espagne
 |
En 1925, il va travailler des taureaux dans des petites arènes, et des pâturages. Il se lie avec le grand matador Belmonte (qui se suicida à soixante-neuf ans en se tirant deux balles dans la bouche).
Fin 1925, il est renversé par un taurillon dans un élevage près d’Albacete en Espagne, où il s’entraîne à toréer. Coup de corne qui taillade la périphérie du poumon. Il crache le sang. On en rit à Paris dans les revues de fin d’année. Son état s’aggrave. Typhoïde et deux congestions pulmonaires. Il va passer quatre mois dans des maisons de santé. Dans une interview à la fin de sa vie (Arch. du XXe s, p.36), il atténue la gravité de ses blessures tauromachiques et ne parle plus de sa typhoïde et de ses congestions pulmonaires ! Ce coup de corne mit fin à ses envies de toréer.
Automne 1926. Convalescence à Tanger. Ses blessures de guerre (sept éclats d’obus) se rappellent à lui. Il souffre dans sa chair la réalité de ses 50% d’invalidité de blessé de guerre.
Le voyageur traqué
Montherlant veut vivre sa liberté, “réaliser la féerie” (comme les délices lus dans les poèmes persans), se dépayser, connaître les mille sensations des voyageurs lues dans les livres. En même temps, Montherlant veut rompre avec son passé. Plus de famille qui le retient. Ils sont tous morts. Il se détache de la religion, du sport, de la guerre. Il va pouvoir vivre, tranquille, “sa grande gourmandise de la créature”.
Il va se rendre compte très vite que cette liberté assoiffée de désirs ne le satisfera pas. Il change sans cesse de lieux de séjour. Il arrive et repart. Il n’est pas heureux. La possession des êtres ne lui donne pas la joie.
“J’eus sur-le-champ tout ce que je voulais, et sur-le-champ en eus par dessus la tête”.
L’imagination magnifique de Montherlant lui promet des félicités inouïes. Mais la réalité le déçoit. Dans le texte Sans remède, du livre Aux Fontaines du désir (Essais, Pléiade, p. 324), Montherlant écrit :
“Le poête qui veut réaliser sa poésie, c’est la lutte contre l’ange. Le poète veut faire toucher terre à l’ange de la poésie. Quelquefois, après bien des efforts, une lutte épuisante, il parvient à terrasser l’ange, mais alors l’ange roulé dans la matière, ses ailes se déplument ; froissé, couvert de crotte ou de poussière, et dans la laideur de la défaite, ce n’est plus qu’un vivant quelconque et que tout divin a abandonné. Et le poête se détournant de lui avec rancœur : “Qu’ai-je fait ! Il était si beau dans le ciel !.”
“Le poète a réellement réalisé tout ce qu’il avait conçu. Il a réellement remporté toute la victoire. Mais sa victoire est sa défaite…”
Montherlant s’aperçoit que “tout ce qui est atteint est détruit”. L’amour, c’est autre chose. Mais le plaisir sexuel est pour lui comme une drogue. Il ne peut s’en passer. Montherlant s’use nerveusement dans ces poursuites qui n’ont pas de fin. C’est la période des Voyageurs traqués, du Voyageur solitaire est un diable.
Dans les livres écrits durant cette période, Montherlant est éblouissant dans ses descriptions de ces populations arabes, des oasis où les touristes s’ennuient, de villes comme Fez, Grenade, Sidi-bou-Saïd, perle de la Méditerranée près de Tunis, et des splendeurs du Sahara. Quel style !
“La nuit close, j’ai repris le chemin de l’oasis. A un endroit où les lézards étaient si nombreux et incœrcibles que les enfants, à quatre mètres du mur, s’asseyaient par terre sur un rang, pour les bombarder à coups de pierres, comme au jeu de massacre forain, il n’y a plus ni un lézard ni un enfant. Un fondouk est allumé ; une humble bougie y met des ombres immenses. Elle est la seule lumière dans toute l’oasis, comme le fanal au mât d’une barque invisible, sur une mer nocturne. Une tortue d’eau, portant un pétale rose sur sa carapace, et qui ne se doute pas que ça lui donne l’air prétentieux, un bourrin rêveur, qui n’a même pas la consolation de savoir qu’il mourra un jour, sont les uniques compagnons de ma mélancolie.” (Le sable et la cendre dans Un voyageur solitaire est un diable, Essais, Pléiade p. 424).
 |
1926, parution des Bestiaires
On retrouve dans ce roman le héros du Songe, Alban de Bricoule, plus jeune de quelques années, avant la guerre, passionné par la tauromachie. Montherlant va faire de la corrida le sujet central du livre, comme une cérémonie religieuse de sacrifice hérité du culte de Mithra. Alban va rencontrer une jeune fille, Soledad, jolie et coquette, qui va le mettre au défi d’affronter un taureau dangereux, le Mauvais Ange, s’il veut qu’elle se donne à lui. Alban de Bricoule vaincra sa peur, affontera le taureau, mais la bête morte, il se détournera de Soledad. Il s’agit d’un roman magnifique, solaire, d’une lecture typique pour adolescent en recherche de beauté !
En 1927, fiançailles poétiques qui ont commencé sur le trottoir du marché aux fleurs de la Madeleine lors d’un de ses brefs retours à Paris.
“Les fiançailles ne durèrent que quatre mois, mais enfin ce furent de véritables fiançailles avec tout ce qu’il faut”. (Archives du XXe siècle, p. 36).
Publication d’Aux Fontaines du désir : ce livre est le reflet de la crise des Voyageurs traqués. C’est comme le Journal de cette crise, avec un ton très varié, plein de poésie, d’images splendides, d’ironie, de vivacité, de passion et de désenchantement.
“Je suis brisé de satiété et j’implore : qui me comblera ?”
En 1928, cette crise des Voyageurs traqués va se dénouer lentement, et sans raison apparente
“Je suppose que l’organisme sent confusément qu’il faut passer à autre chose, qu’il ne faut pas s’endormir dans un état, quand mille états différents nous appellent, y compris l’état opposé. Je suppose que cette crise cessa parce que je tendais à m’y endormir (…) Qu’avait-elle été cette crise ? D’abord une crise assez grossière de satiété sensuelle. Puis une sorte d’explosion d’adolescence retardée (…) Il faut que barbarie se passe, disait l’abbé Brémond. Barbarie se passa.” (1935, avant-propos de Service inutile).
Montherlant dira :
“Les années 26, 27, 28 et 29, je ne fus pas très heureux bien qu’ayant ma liberté. J’avais de l’argent qui me venait de ma grand-mère, et de la fortune ; j’étais seul, je faisais tout ce qui ma passait par la tête et qui consistait à aller d’un bord à l’autre de la Méditerranée.” (Archives du XXe siècle, p.36).
L’écrivain est très lucide. Le voyage et ses plaisirs ne sont pas pour lui.
“Cette période qui aurait dû être magnifique, n’a pas été bonne”.
1929
Publication de La Petite Infante de Castille
Le “voyageur traqué” est tombé amoureux d’une petite danseuse espagnole. Au moment de la posséder, il s’éclipse, il “goûte la puissante satisfaction d’avoir refusé, pouvant, de n’avoir pas voulu”.
Publication de L’Exil
Pièce de théâtre en trois actes, écrite en 1914, où Montherlant raconte le conflit entre un jeune homme qui veut s’engager pour rejoindre un ami qui est au front, lors de la Première Guerre, et sa mère qui s’y oppose de peur de le perdre. Montherlant montra toujours une grande fierté pour la quasi-perfection de ce drame.
 |
1929-1932
Il va continuer à voyager en Espagne, en Méditerranée et finit par s’installer complètement à Alger, dans un appartement meublé où il commence à écrire La Rose de sable. Il comprend que ce qui lui avait manqué durant ces quatre années de liberté absolue, païenne, c’était d’écrire. Quand il commence La Rose de sable, il devint pleinement heureux. Il avait retrouvé sa voie, sa passion, qu’il n’aurait pas dû délaisser.
Ce roman est très antifrançais, très anticolonialiste. Montherlant est scandalisé d’observer la manière dont sont traités les Musulmans par les Français d’Algérie (non pas ceux du Maroc ou de Tunisie).
Au bout de ces deux ans et demi de très grand bonheur, il revient en France.
La Rose de Sable ne sera publiée qu’en 1967 dans sa totalité. Pourquoi ?
“Parce qu’en 1932, Hitler est nommé Chancelier, et Mussolini ne cessait d’insulter la France. Je ne voulais pas ajouter ma petite goutte d’eau, si mince fût-elle, à l’orage de ces gens-là. Dès 1932, les Italiens voulaient mettre la main sur la Tunisie.” (Archives du XXe siècle, p.37).
Il gardera donc La Rose de sable dans ses tiroirs pour ne pas en rajouter dans ce qui aurait pu être interprété comme une attaque contre la France.
En 1932, publication de Mors et Vita. Cet ouvrage réunit plusieurs textes inspirés par sa guerre de 1918. Très vite,il sent qu’une nouvelle guerre se prépare. “La main de la guerre m’empoigne et me rabat rageusement vers elle”. Il va décrire l’attitude qu’il eut devant le courage, la peur et la mort. Il souhaite une paix qui ait la grandeur d’âme de la guerre.
1934
Publication d’un livre de poèmes, Encore un instant de bonheur. Montherlant est un immense poète. Il y a, dans ce livre, des poèmes d’inspiration africaine suite à son expérience d’Afrique du Nord, et des poèmes d’inspiration française, où on retrouve la source poétique des Olympiques.
Montherlant rentre en France et est accueilli à Paris avec chaleur. Pris par sa passion d’écrire, il s’attaque à un roman Les Célibataires, qui obtiendra le Grand Prix de Littérature de l’Académie Française (1934).
Les modèles de ceux-ci seraient, en partie, le grand-oncle Pietro de Courcy, mort en 1941 (frère de la grand-mère d’Henry, pour le baron Elie de Cœtquidan), et l’oncle Henry de Riancey (frère de la mère d’Henry, pour le comte Léon de Coantré), et qui tous deux, célibataires, originaux, déconnectés de la vie réelle, vécurent à Neuilly, avec l’écrivain, la grand-mère et les parents d’Henry de Montherlant.
Montherlant note que les modèles étaient morts, et cependant, Sipriot indique que Pietro de Courcy décède en 1941. Détail. Mais pourquoi Montherlant écrit-il : “Les modèles étaient morts, le sujet était donc plus facile, c’est pourquoi je le choisis.” ? (Archives du XXe siècle, p.37).
 |
|
Ce roman très classique, parfois balzacien, raconte la progressive déchéance de deux gentillommes déclassés, sans défense face à la vie moderne. Montherlant décrit avec ironie, âpreté et tendresse la solitude tragique de ces deux vieux nobles complètement perdus. Montherlant évoque dans ce livre, avec allégresse et férocité, les milieux d’affaires, du notariat, de la médecine, et l’hypocrisie des relations familiales. Par contre, il a une tendresse évidente pour les petits, les pauvres et les abandonnés. “Personne n’aime personne”. Il y a dans ce livre des pages admirables d’émotion et de poésie, notamment celles qui racontent les dernières heures de Léon de Coantré.
Ce roman connut un immense succès, et attira l’attention sur les aristocrates ruinés, incapables de se maintenir dans leur classe sociale, au point que Montherlant fut invité à donner une conférence sur le sujet devant l’Association de la Noblesse de France !
Secondes fiançailles, “avec notaire à la clé et tout le saint-glinglin”.
“J’eus une amitié affectueuse pour cette jeune personne pendant huit mois exactement et à la fin je me fiançai. Ces huit mois, mon Dieu, je dois dire que je les ai un peu racontés dans Les Jeunes Filles. Ce n’est pas du tout la jeune fille qui avait parlé la première de mariage : c’est moi, très imprudemment”.
Le modèle serait donc la jolie Solange Dandillot, parfois malmenée par Costals le héros du livre. Mais Montherlant se défiancera rapidement, convaincu qu’il n’était pas fait pour la cohabitation.
“J’ai besoin d’être seul (…) et j’étais extrêmement volage, papillonnant.” (Archives du XXe siècle, p. 37).
En 1935, parution de Service inutile
Ce livre groupe des textes qui comportent tous un jugement moral. Montherlant écrit :
“Au mot service, qu exprime bien le caractère de ces textes, il était indispensable d’ajouter inutile“. Dans ce livre, Montherlant dénonce ce qu’il déteste, “la bassesse, la vulgarité, la malhonnêteté, l’absence de naturel, la lâcheté” et prône les vertus contraires, soit “une morale de la qualité, le courage, le civisme, la fierté, la droiture, le mépris, le désintéressement, la politesse, la reconnaissance, et tout ce qu’on entend par le mot de générosité.” (Lettre d’un père à son fils).
Ces pages permettent de mieux comprendre la crise (“voyageur traqué”) de l’auteur entre 1925 et 1935.
 |
|
De 1936 à 1939, Les Jeunes filles
Publication de la série romanesque des Jeunes Filles en quatre tomes,
- Les Jeunes Filles (1936),
- Pitié pour les femmes (1936),
- Le Démon du bien (1937), et
- Les Lépreuses (1939).
Immense succès et gros scandale ! Plus d’un million d’exemplaires vendus avant la guerre de 1940 ! Et plusieurs millions d’exemplaires vendus à ce jour ! Pour Montherlant, “c’est un livre composé de gags à la Charlot, un livre comique, au second degré, ce que le public n’a peut-être pas vu.” (Archives du XXe siècle, p. 38). Ce livre subira la fureur des féministes et de Simone de Beauvoir.
Dans un ouvrage qui recense “Les 1001 livres qu’il faut avoir lus dans sa vie” (Flammarion 2006, p. 387), Les Jeunes Filles sont retenues comme une des œuvres majeures du XXe siècle :
“Les ligues féministes de l’entre-deux-guerres attaquèrent durement le cyle des Jeunes Filles, faisant à Montherlant une réputation d’auteur misogyne qui ne le lâchera plus. En réalité, c’est de la difficulté des sentiments qu’il traite dans ces romans d’un moralisme ambigu et d’un humour sarcastique. La variété des formes (lettres, journal intime, narration traditionnelle) et la splendeur classique de la langue en font un régal pour les amateurs de grand style.”
Le critique Henri Perruchot, dans son Montherlant (1959), écrira :
“Montherlant prononce un terrible réquisitoire contre ces maux graves de l’Occident moderne qui lui semblent typiquement d’essence féminine : l’irréalisme, le dolorisme, le vouloir-plaire, le grégarisme, le sentimentalisme”.
 |
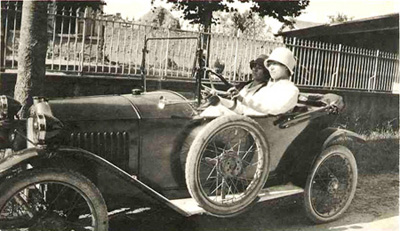 |
 |
||
|
Alice Poirier, amie de Montherlant, en 1928. A droite, Alice Poirier, jeune fille. |
||||
En 1938, parution de L’Equinoxe de septembre
Montherlant est un des rares écrivains français, avec Aragon, à s’en prendre avec virulence aux accords de Munich entre Hitler et les Alliés. Montherlant est persuadé que la guerre éclatera et qu’il faut se battre. Montherlant fustige la France, minée par la morale de midinette. Ce livre d’essais se rapporte directement aux évènements de 1938 et au “climat” des années précédentes. Il est comme une suite à Service inutile.
“Allemands, Français, qu’y a-t-il devant nous ? Il y a devant nous la possibilité d’une nouvelle guerre. Cette possibilité est même, sans doute, une forte possibilité.” (L’Equinoxe de Septembre, Le parapluie du samouraï).